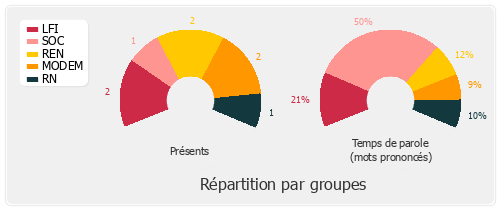Commission d'enquête sur les causes de l'incapacité de la france à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l'exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire
Réunion du jeudi 21 septembre 2023 à 9h00
La réunion
Jeudi 21 septembre 2023
La séance est ouverte à neuf heures.
(Présidence de Mme Anne-Laure Babault, vice-présidente de la commission)
La commission procède à l'audition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) :
– Mme Charlotte Grastilleur, directrice générale déléguée du pôle « produits réglementés » ;
– Mme Gabrielle Bouleau, présidente du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts de l'ANSES ;
– M. Jean-Luc Volatier, adjoint au directeur « Observatoires, données et méthodes ».

Nous poursuivons ce matin les auditions de notre commission d'enquête sur les produits phytosanitaires. Je précise que notre président, M. Frédéric Descrozaille, n'a pas pu se libérer aujourd'hui et m'a demandé de le représenter. C'est donc avec plaisir que je présiderai notre commission pour les deux auditions de ce matin. Depuis hier, il ne vous aura pas échappé que nous sommes rentrés dans le vif du sujet avec l'audition de l'Efsa, l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Nous avons abordé la question complexe des conditions nécessaires à l'autorisation de substances dont nous savons qu'elles peuvent être dangereuses pour la santé et pour l'environnement, précisément parce que leur objectif est de détruire des adventices, des insectes et des champignons dans le but de protéger les cultures. Nous avons évoqué la difficulté de conduire au préalable des évaluations prenant en compte l'ensemble des impacts potentiels en vie réelle. Nous avons également abordé la problématique des conflits d'intérêts et l'enjeu de garantir l'indépendance des évaluations scientifiques – par rapport à l'industrie phytopharmaceutique en particulier.
Nous allons en quelque sorte prolonger ce débat ce matin avec l'audition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'Anses. L'Anses est devenue un acteur central en matière d'évaluation des risques et d'autorisation des produits phytosanitaires en France depuis le 1er juillet 2015, date à laquelle la délivrance des autorisations de mise sur le marché de ces produits lui a été transférée. Elle assure également, depuis cette date, une mission de phytopharmacovigilance pour les produits autorisés.
Au regard de tous les travaux scientifiques qui nous ont été présentés lors des premières auditions, nous avons constaté que cette évaluation des risques, ce processus d'autorisation, cette phytopharmacovigilance apparaissaient globalement insuffisants aujourd'hui. Nous allons donc chercher les moyens de les renforcer dans le cadre européen qui s'impose à nous – et peut-être aussi de faire évoluer ce cadre européen.
Mesdames, Monsieur, je vous remercie de vous être rendus disponibles pour notre commission d'enquête. Je vais à présent vous laisser la parole pour une brève présentation de vos fonctions et des missions de l'Anses en matière de produits phytosanitaires. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ».
(Madame Grastilleur, Mme Bouleau et M. Volatier prêtent successivement serment.)
Je suis directrice générale déléguée pour le pôle des produits réglementés. Dans ce pôle de l'Anses, nous avons souhaité incorporer le traitement d'un certain nombre de dossiers spécifiques en ce qu'ils prévoient non seulement l'évaluation des risques, mais également la décision. Nous traitons donc à la fois des produits biocides – par exemple, désinfectant pour les toilettes, traitements pour le bois, produits antifouling pour les coques de bateaux –, des produits d'hygiène vétérinaire, des médicaments vétérinaires, des produits phytopharmaceutiques et également des matières fertilisantes, un peu moins connues et représentant une volumétrie de travail moindre, mais avec une logique similaire.
La compétence en matière d'autorisation de mise sur le marché nous a été transférée en 2015 pour les produits phytosanitaires. Forts du succès de cette entreprise, nous avons ensuite reçu la compétence en matière d'autorisation des biocides en 2016. Pour les médicaments vétérinaires, notre compétence est plus ancienne, puisqu'à l'origine, nous avions une agence dans l'agence.
L'idée générale est d'appuyer la décision en matière d'autorisation sur une évaluation – évaluation qui est conduite au sein de l'agence sur ces produits. Il s'agit bien d'un processus d'ensemble. Pour répondre aux questions d'expertise et d'évaluation, on qualifie des experts externes dans le cadre de nos collectifs d'experts, quel que soit l'objet traité. La décision que nous prenons ensuite s'appuie sur les conclusions de ce collectif. Je précise que nous publions systématiquement les décisions assorties des évaluations scientifiques réalisées sur notre site internet ; j'invite chacun et chacune à consulter. Tout le monde peut donc constater sur quelle base d'évaluation notre décision a été prise et pointer un éventuel écart entre l'expertise qui nous a été proposée et la décision. C'est un point extrêmement important.
Nous sélectionnons les experts du collectif conformément aux règles de l'agence – ce qui implique une déclaration d'intérêts publique – dans le cadre d'un appel à candidatures très ouvert, sur la base de leur CV et de leurs publications. Nous pouvons également tenir compte de leur position institutionnelle, puisque leurs missions du quotidien ont une importance, même s'ils viennent auprès de nous intuitu personæ et non en représentation d'un institut, ce qui offre par ailleurs une latitude tout à fait importante dans leur expression scientifique. Nous sommes ainsi à même de recruter de manière pluraliste et sans a priori.
En conclusion, il y a donc vraiment un sens commun à l'ensemble de ces missions de l'Anses, qui a les sujets sanitaires dans son ADN – ce qui, d'ailleurs, figure dans son intitulé et dans sa mission au titre du code de la santé publique. J'insiste sur le fait que ces missions, pour complexes qu'elles soient, avec une capacité de décision embarquées, n'échappent pas à nos règles générales, y compris en matière de déontologie.
Je suis ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, spécialiste des politiques liées à l'eau et chercheuse en sciences politiques à l'Inrae. J'ai rejoint le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts (CDPCI) en 2019. J'en ai été élue présidente en 2020 pour la fin d'une mandature et, à nouveau, en 2021, pour cinq ans.
Ce comité a été créé en même temps que l'Anses, en 2010. Il est composé de cinq à huit membres nommés pour cinq ans par arrêté des ministres de tutelle, sur proposition du conseil d'administration. Ses membres n'appartiennent à aucune autre instance de l'Anses, n'ont aucune relation contractuelle avec elle et sont soumis aux obligations déontologiques applicables à l'agence. Le CDPCI peut être saisi par le conseil d'administration de l'Anses, par son conseil scientifique, par un comité d'experts et par son directeur général. Ce dernier doit mettre à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement ; il est par ailleurs tenu de prendre les décisions nécessaires à la mise en œuvre de ses recommandations. Actuellement, nous sommes au total sept membres : un philosophe, un juriste, une inspectrice générale chargée de l'appui aux personnes et aux structures (Igaps), deux médecins, un biologiste et une politiste.
Notre travail est d'édicter des règles assez générales. Nous ne travaillons pas sur des dossiers particuliers d'autorisation, mais plutôt sur des règles de déontologie qui s'appliquent à l'ensemble du processus, pour garantir l'impartialité des experts et donc de l'expertise – c'est-à-dire leur indépendance, leur intégrité et leur probité –, mais aussi le respect de la transparence, de la pluralité et du contradictoire. Le comité a toute liberté pour fixer son calendrier de travail, auditionner les personnes qu'il souhaite et écrire son rapport et ses recommandations. Il se réunit chaque mois pour débattre des propositions qui ont été écrites dans l'intervalle. Il est attaché à ce que les comités d'expertise soient des lieux de débat scientifique où l'expression d'avis éventuellement minoritaires soit possible. Il produit entre un et cinq avis par an, tous publiés en ligne.
L'unité de phytopharmacovigilance de l'Anses est positionnée au sein du domaine « méthodes, observatoires et données » dont je suis le directeur-adjoint. La phytopharmacovigilance a été mise en place par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014. Elle a été confiée à l'Anses pour deux raisons. Premièrement, l'Anses est en effet en charge de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques et de la délivrance des AMM depuis 2015 ; ce fut donc un peu en anticipation de cette nouvelle mission. Par ailleurs, depuis le début des années deux-mille, l'Anses coordonnait l'observatoire des résidus de pesticides. De ce fait, elle exerçait déjà une mission de suivi des impacts des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l'environnement, par l'analyse de leur présence dans les milieux.
La phytopharmacovigilance a pour objectif principal d'évaluer les impacts sur la santé humaine et l'environnement des usages des produits phytopharmaceutiques au sens strict. Cela n'inclut donc pas les biocides et les antiparasitaires utilisés dans le domaine vétérinaire, lesquels font partie des pesticides au sens large.
Au sein du domaine « méthodes, observatoire et données », nous avons ainsi mis en place une équipe pluridisciplinaire composée d'agronomes, d'épidémiologistes, de spécialistes des transferts des substances dans les milieux, d'ingénieurs, de modélisateurs et de statisticiens. Cette équipe s'appuie également sur des ressources externes, notamment un groupe de travail « phytopharmacovigilance » qui comprend vingt experts scientifiques extérieurs à l'agence – comme tous nos comités d'experts spécialisés – ainsi que des sous-groupes portant sur la biodiversité, la santé humaine et la contamination des milieux. Ces experts externes permettent d'orienter nos travaux.
Nous ne sommes pas seuls à travailler sur la phytopharmacovigilance. Je souligne l'existence d'un réseau de vingt partenaires extérieurs à l'agence, principalement des établissements publics en charge de la surveillance, comme l'Office français de la biodiversité (OFB) pour la surveillance des eaux de surface, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) pour les eaux souterraines et le réseau Atmo, qui regroupe des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (Aasqa), pour la surveillance des résidus dans l'air. Je signale aussi l'existence de la cohorte Agrican, qui est la principale cohorte française sur le suivi de la santé des travailleurs agricoles, agriculteurs ou salariés. Je peux également citer l'Institut technique du domaine apicole (Itsap) qui évalue les impacts sur la santé des abeilles.
Grâce à ce réseau, nous couvrons un large spectre d'impacts potentiels. Il permet de nous transmettre à la fois des signalements et des données, en vue de bâtir des études. Je précise que nous disposons par ailleurs d'un budget d'études d'un peu plus de 1,5 million d'euros par an, qui nous permet de diligenter des études sur le conseil de notre groupe de travail d'experts externes, sur des sujets pour lesquels les données manqueraient dans le cadre du réseau que nous venons d'évoquer. Nous contractons ainsi avec des équipes d'épidémiologie ou d'écotoxicologie, selon les types de sujets traités.
Ces moyens nous permettent de réaliser des études par substance, lesquelles sont transmises au pôle « produits réglementés » de l'Anses en amont des évaluations de produits. Nous recensons à ce jour 59 fiches substances publiées sur le site de l'agence. Les résultats d'études font l'objet de publications par les équipes de recherche qui en sont à l'origine. Nous avons pour le moment financé 45 études, dont 39 sont terminées et sont soit publiées, soit en cours de publication par les équipes de recherche.

Par vos différentes compétences, vous serez en mesure, je n'en doute pas, de répondre à l'ensemble de nos questions sur l'impact des produits phytosanitaires sur la santé et l'environnement, sur la phytopharmacovigilance, sur l'indépendance des évaluations – question qui nous est chère – et globalement sur la délivrance des autorisations de mise sur le marché.

Il s'agit d'une audition clé pour notre commission d'enquête. C'est bien la remise en cause des missions, du statut et de la place de l'Anses dans l'évaluation et l'autorisation des produits phytosanitaires qui a été l'une des motivations principales pour demander cette commission, au-delà de l'évaluation globale de l'efficacité des plans Ecophyto.
Je laisse volontiers les sujets d'actualité, autour du glyphosate notamment, à mes collègues. Je suis sûr que nous aurons des questions sur les conséquences des résultats annoncés par l'Efsa à ce sujet.
En premier lieu, je souhaiterais poser des questions à vocation pédagogique, puisque cette audition est publique et nous donne l'occasion d'expliquer très clairement le fonctionnement, les raisons, le sens et les modalités de votre action.
Ma première question vous surprendra peut-être ; l'Efsa a souligné que l'Union européenne était la plus avancée au monde, sur le plan scientifique et sur le plan déontologique, en matière de gestion des produits phytosanitaires. Quelles études et quels marqueurs nous permettent de confirmer, de la même manière, le positionnement international de l'Anses quant à qualité de son expertise scientifique et à aux garanties d'indépendance qu'elle présente ?
Cette question est complexe. Tout d'abord, il me semble essentiel de rappeler que nous sommes un établissement public à vocation de recherche, même si nous avons le statut d'établissement public administratif. Nous sommes ainsi avant tout une agence d'expertise et d'évaluation des risques, avec une vocation de recherche. Comme pour toutes les autres institutions scientifiques, notre excellence est ainsi révélée par la qualité de nos publications. Mon collègue a exposé une partie des travaux qui sont les nôtres ; il a notamment mentionné le nombre très satisfaisant de nos publications dans des revues à comité de lecture. Nous avons des équipes à la pointe sur le plan scientifique. Il s'agit là d'un premier élément de réponse évident : l'aura des publications de l'Anses parle pour nous.
Je complèterai avec une réponse plus personnelle : je pense que ce qui nous distingue, c'est aussi notre capacité à commenter régulièrement les travaux des uns et des autres, à l'occasion des revues par les pairs au sein de l'Union européenne. Je rappelle que l'autorisation des produits phytopharmaceutiques revêt une dimension zonale au sein de l'Union européenne : contrairement à ce que certains pensent, la France n'est pas seule dans son coin. Nous nous situons dans la zone sud avec des pays assez variés tels que Malte, l'Espagne ou l'Italie – laquelle est relativement proche en termes de structure agricole et, dans une certaine mesure, d'organisation interne, beaucoup moins pour l'expertise.
Au sein de cette zone, lorsqu'un État membre est chargé du rapportage en vue de l'autorisation d'un produit, nous sommes actifs dans le commentaire, les vérifications et les échanges entre pairs. Contrairement à ce que l'on imagine parfois, l'Anses n'est pas dans sa tour d'ivoire, à conduire un travail qui serait uniquement franco-français. Et nos commentaires sont régulièrement repris, questionnés ; ils peuvent, in fine, modifier une partie des travaux de rapportage et d'évaluation sur ces produits.
Par ailleurs, je me permets d'évoquer, avec toutes les précautions utiles, les remontées des industriels, lesquels se tournent vers nous sur certains rapportages parce qu'ils estiment qu'une fois que leur dossier est passé sous les fourches caudines de nos évaluateurs, il a de bonnes chances d'aboutir dans d'autres États membres : « quand je suis passé par l'Anses, au moins, tout a été vérifié et je suis tranquille. ». Nous conduisons en effet une revue très exhaustive du dossier, au plus près des méthodologies d'évaluation européennes. Cela témoigne également de la qualité de notre expertise.

Cette appétence des opérateurs privés pour l'Anses pourrait paraître ambiguë ; mais l'on comprend bien, à ce que vous nous expliquez, quelle en est la logique : une fois que l'on est passé par l'Anses, la norme scientifique et déontologique est très élevée. Je vous remercie d'avoir levé cette ambiguïté.
Sur ce point, les firmes elles-mêmes nous reprochent très régulièrement de ne pas avoir un accès suffisant à nos équipes, précisément parce que tous ces contacts ont été parfaitement codifiés. Nous ne pouvons interférer avec les firmes qu'à certaines étapes précises.
Je reviens à un aspect fondamental : même si la décision d'autorisation relève de l'agence, nous avons la garantie de l'indépendance de l'expertise scientifique. Je rappelle que le collectif d'experts est constitué de personnes extérieures à notre agence, qui ont toute latitude pour s'exprimer et à formuler des avis minoritaires. Une fois que le dossier arrive entre leurs mains, aucune interaction d'aucune sorte n'est possible avec des décideurs de l'agence ou même avec des acteurs qui ne sont pas dans la coordination de l'expertise – encore moins avec les firmes, c'est une certitude.

Sur le plan scientifique, pouvez-vous affirmer qu'une agence en Europe, en Asie, en Amérique est supérieure à la nôtre, plus puissante et plus pertinente ? Je poserai la même question sur le plan déontologique.
Il n'existe pas véritablement de réponse. Nous avons de hauts standards de qualité et nous pouvons en attester par notre production scientifique et par la reconnaissance de nos pairs. Il ne s'agit pas forcément de dire que nous serions meilleurs ou moins bons que le BfR allemand (Bundesinstitut für Risikobewertung) ou qu'une autre agence. Il existe des agences de grande qualité en Europe ; elles sont véritablement portées vers l'avant quand elles ont, en plus, la capacité d'embarquer de la recherche en leur sein, ce qui est notre cas. C'est un fait, même si nous n'aspirons pas à nous comparer.

Une telle compétition peut être saine. Par ma question, j'aspirais surtout à faire ressortir les meilleurs standards internationaux vers lesquels nous pourrions nous diriger.
J'ai très bien compris votre question. Mais il est complexe de comparer, hormis sur la base de critères scientifiques usuels. En Europe, avec la perspective zonale que j'évoquais, nous sommes dans une logique de coopération visant à tirer l'ensemble des agences vers le haut, chaque agence étant en mesure, à un moment donné, d'évaluer en corapportage avec une autre.
Notre comité de déontologie n'a pas d'équivalent en Europe, ce qui signifie aussi que nous atteignons un niveau d'indépendance sans égal. Nous évoluons dans un système un peu particulier qui permet au comité de déontologie d'avoir un rôle d'irritant sur tout ce qui pourrait se passer au sein des comités d'expertise. Au regard de ce que j'ai pu constater depuis que je participe au comité de déontologie, et d'après ce que j'ai pu lire sur ce qui s'est fait auparavant, il n'existe aucune volonté de cacher quoi que ce soit dans les avis du comité ; au contraire, il s'agit d'apprendre à partir des cas de difficultés. J'en veux pour exemple la charte des relations avec les porteurs d'intérêts. Une charte avait en effet été établie au sein de l'Anses, demandant la réalisation d'un registre de l'ensemble des visites des porteurs d'intérêts ; l'analyse de ce registre avait montré que 95 % des visites étaient liées au secteur agricole et associé, ce qui n'était pas de nature à garantir l'équité d'accès à l'agence. En 2019, le comité de déontologie a donc recommandé à l'Anses de limiter au maximum les rencontres avec les porteurs d'intérêts. Des rencontres peuvent être organisées pour expliciter une décision prise mais, en dehors de ce cas, il est préférable que l'Anses rencontre les parties prenantes dans des dispositifs pluralistes de type plateforme, où toutes les parties prenantes peuvent être invitées. Ce point a été réaffirmé par le comité de déontologie en 2021, sur les maladies professionnelles.
Par ailleurs, le comité de déontologie n'a pas pour objectif de se satisfaire d'une forme d'excellence scientifique qui serait conviée dans les différents comités d'expertise, mais de garantir les conditions d'expression de tous les avis de ces scientifiques, y compris des savoirs inconfortables, et de faire en sorte que des données qui sont des présomptions soient entendues. Nous savons que le niveau d'alertes remontant par la phytopharmacovigilance est plutôt faible ; le comité a donc été amené, dans ses avis, à recommander la prise en compte de toutes ces alertes. Pour que cette affirmation soit entendue, pour que ce principe fonctionne dans les comités d'experts, il est nécessaire de rappeler sans cesse à tous les scientifiques que nous ne pouvons que les encourager à participer à ces comités même si, dans le domaine de la recherche, cette participation n'est pas forcément une activité valorisée, quelle que soit la discipline, y compris en sciences sociales. Cet investissement de l'ensemble de la communauté scientifique importe pour la qualité du processus collégial.
On ne peut jamais se satisfaire du point d'arrivée en matière de déontologie. Dans les comités, nous sommes systématiquement attentifs à tous les cas qui pourraient montrer que, de façon pragmatique et malgré les règles, des voix se taisent, n'osent pas parler, peut-être parce qu'elles ne connaissent pas encore bien ces règles. Le processus doit sans cesse être amélioré pour que tous les savoirs soient véritablement réunis au moment de l'expertise.

Nous avons vécu un avant 2014 et un après 2014. Que ferons-nous demain ? Pouvez-vous nous expliquer comment étaient données les autorisations de mise sur le marché avant 2014 ? Pouvez-vous revenir sur la décision politique qui a changé la donne, sa signification, ses conséquences ? Enfin, quel regard portez-vous, depuis l'Anses, sur les débats que nous pressentons actuellement au sujet de cette procédure ?
Je vous remercie de poser cette question d'organisation qui emporte de nombreuses conséquences politiques. Auparavant, le régime en place pour l'évaluation des produits avant leur mise sur le marché était tout à fait analogue, même si les règles déontologiques se sont renforcées depuis. Nous avions déjà recours à des collectifs d'experts indépendants, dont les conclusions étaient transférées aux décideurs politiques. À partir de 2014, nous avons renvoyé la décision d'autorisation de mise sur le marché à l'Anses. Je pense que la conséquence essentielle de ce transfert est la lisibilité, la clarté et la cohérence dans la chaîne entre la décision et l'évaluation, puisque la décision est directement articulée à l'évaluation. Cependant – j'insiste sur ce point – les évaluateurs et les décideurs appartiennent à deux équipes disjointes qui n'influent pas les unes sur les autres. Nous sommes néanmoins dans la même agence. Il en résulte, pour mes collègues des autorisations, une capacité plus aisée à décrypter ce que les experts nous proposent, puisqu'ils peuvent se nourrir les uns des autres, tout en étant dans le respect du rôle de chacun : une fois les conclusions terminées, je les transmets et suis en mesure de vous les expliquer pour que votre décision soit en ligne avec ce qui a été observé au sujet du risque.
Ainsi, nous n'avons pas de latitude politique pour aménager la décision en fonction des besoins de telle ou telle filière – j'insiste sur ce point.
M. Vallet s'en est expliqué, s'agissant de l'interdiction du S-métolachlore. Le règlement européen, qui a force de loi en France, n'emporte aucune dérogation. Nous avons un bloc d'expertises, le niveau de risque acceptable défini par le législateur : notre décision est directement branchée sur ces deux éléments. La prise en compte de faits exogènes – comme les problèmes d'une filière qui manquerait de solutions pour traiter – n'est ni permise ni prévue dans le texte. Ce qui ne veut pas dire que nous nions la réalité de ces difficultés.
Dans d'autres États membres, on constate parfois une certaine disjonction entre l'évaluation et la décision, même si nous ne sommes pas dans les arcanes de leurs décisions. La décision peut y être plus ou moins aménagée, à des fins parfois économiques ou autres. Pour ce qui nous concerne, nous avons au moins une lisibilité, un bloc global, une capacité à décoder la science directement pour la décision. Il existe néanmoins des mécanismes d'aménagement de cette décision – je pense en particulier à cette fameuse dérogation des 120 jours.

Je souhaiterais que nous fassions preuve de pédagogie. Vous rendez désormais un rapport comportant les deux blocs de l'évaluation et de la décision. La signature intervient à la fin. Auparavant, vous rendiez le rapport et des ministres décidaient. Nous n'avons pas précisé quel était le ministère compétent ?
C'était le ministère de l'Agriculture.

Vous rendiez votre décision, une signature du ministre était in fine apposée, mais elle ne pouvait pas contredire votre conclusion.
Non, je vous invite à consulter ces éléments. Avec le collectif d'experts, nos collègues évaluateurs fournissent des conclusions signées du directeur de l'évaluation. Ce bloc de conclusions est communiqué au directeur chargé des autorisations. Nous avons en effet besoin de connaître l'impact de la décision, même si nous avons peu de latitude. Ce directeur apprécie l'impact, convertit les évaluations en décision et notre directeur général en porte la responsabilité, y compris juridique. Il existe cependant une exception qui permet au ministre de l'Agriculture et, par délégation, à la direction générale de l'alimentation, de porter la décision.
Une fois que l'Anses a retiré l'autorisation de mise sur le marché d'un produit, le ministère de l'Agriculture peut décider d'appliquer une dérogation de cent-vingt jours, correspondant à la durée d'épandage de ce produit pour une période de culture annuelle – dérogation éventuellement renouvelable et qui ne dépend plus de l'Anses. Cette décision de dérogation vise à alléger les difficultés que pourrait rencontrer une filière après une décision d'interdiction.

Même sur le plan formel, une fois que l'interdiction est prononcée, aucune autorité politique ne peut donc revenir dessus, excepté dans le cas d'un aménagement calendaire pouvant être assorti de restrictions d'usage sur une condition en particulier.
En vertu du code rural, le ministre peut demander à ce que nous revérifiions notre évaluation mais il ne peut en aucun cas nous intimer l'ordre de modifier notre décision.

Auparavant, c'était le ministre qui décidait. Pour simplifier, nous pouvons affirmer que l'expertise était de même nature mais le ministre pouvait prendre une décision contraire à la recommandation de l'Anses. À partir de la loi de 2014, applicable à compter de 2015, hormis le cas de dérogation calendaire évoqué tout à l'heure et sauf demande de vérification – laquelle pourrait s'apparenter à une façon de gagner du temps – la décision est prise par l'Anses en fonction d'arguments scientifiques de toxicité tels que nous les avons décrits. C'est une petite révolution. Est-ce le cas dans d'autres pays de l'Union européenne ou sommes-nous une exception en la matière ?
Les organisations sont très variables d'un pays à l'autre ; certains décomposent le dossier d'évaluation et envoient un segment, par exemple la toxicologie, dans une université, un autre dans un institut technique agricole, s'agissant de la question de l'efficacité du produit. Il conviendrait de réaliser un inventaire complet, que je ne me permettrais pas de faire ici, sans avoir toutes les données en tête. Je pense que nos collègues du ministère de l'Agriculture doivent avoir ces informations. Je peux cependant nous comparer à l'agence néerlandaise, le CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden), que je connais bien ; c'est une structure ad hoc assez proche de l'Anses, avec un mode de fonctionnement assez original. Notre structuration n'est pas inédite en Europe. Il serait toutefois nécessaire de faire un parangonnage plus complet.
Monsieur Potier, vous évoquiez des décisions concernant les autorisations de produits qui auraient été, auparavant, de nature politique. Je pense qu'il y a eu, en effet, des positions politiques en la matière. Mais gardons à l'esprit que le texte européen qui constitue le support de nos décisions est le même depuis 2009, et ce texte ne prévoit pas d'exception, que la décision soit portée par le ministre ou par le directeur général de l'Anses. Dans le texte européen, il n'y a pas de marge de manœuvre pour ajuster la décision aux filières. Le signataire de la décision n'y change rien, la question juridique reste la même, la situation juridique également.
La responsabilité pénale est différente.
C'est lui qui signe.

Je pense que c'était important que nous mesurions tous bien ce qu'a été la révolution de 2014, laquelle a fait de notre système l'un des plus exigeants en Europe. Dans ce que vous pressentez des débats actuels auxquels vous n'êtes pas étrangers, le retour à la situation d'avant 2014 est-il envisagé ou serait-ce plutôt le recours à des formules plus byzantines ? Cette question est peut-être délicate.
Comme tout un chacun, nous sommes traversés par les questionnements émis par voie de presse notamment ; et nous n'ignorions pas les positions politiques exprimées à notre endroit par les uns ou les autres. Il s'agit ici d'autoriser, par exception, un produit, lorsque son interdiction fait grief à une filière. Indépendamment du montage utilisé, on en revient en réalité à la même donnée : le règlement européen comporte des critères d'acceptabilité. Même si l'entreprise demande l'autorisation, même si le ministre signe, le texte européen s'opposera à eux : leur responsabilité sera engagée, en particulier celle des firmes, qui sont les premières responsables.
Vous évoquiez la question des solutions juridiques qui pourraient être trouvées à un certain nombre d'impasses, en particulier ces fameuses impasses de traitement. Dans le cadre du texte européen tel qu'il est rédigé, il n'existe pas réellement de solution juridique. Nous nous inscrivons vraiment dans une logique très forte, qui est une logique industrielle de recherche de solutions alternatives mieux-disantes sur le plan sanitaire. La question n'est donc vraiment pas tant de savoir qui signe, car le texte européen comporte des verrous de sécurité – même si, je vous le concède, les textes peuvent être modifiés.

Je formule l'hypothèse que même avec les verrous que vous évoquez, si les solutions industrielles alternatives se faisaient attendre, nous pourrions nous distraire de cet objectif et amortir les vieilles molécules encore plus longtemps.
Vous avez diligenté un groupe de travail qui a produit un rapport sur la question de la confiance dans l'expertise scientifique. Vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question, qui traverse toutes les démocraties. Quelles sont les grandes lignes de ce rapport ? Avez-vous déjà commencé à en tirer les conclusions en interne ou est-ce que cela supposerait des réformes à caractère réglementaire ou législatif ?
Ce rapport a été produit par notre conseil scientifique ; c'est un point important. J'insiste beaucoup sur le fait que de nombreux observateurs externes sont présents à des points clés de notre gouvernance et de nos activités. J'ai évoqué les collectifs d'experts, les experts externes, les académiques, les personnes d'établissements publics. Nous avons recours à leurs services ; l'Anses n'opère pas seule dans son coin. Par ailleurs, notre conseil d'administration est composite et reflète la multiplicité des enjeux couverts par les différents dossiers sur lesquels nous avons compétence.
Le conseil scientifique est également composé de personnalités qualifiées externes, reconnues pour leurs compétences scientifiques très diverses, bien que n'embrassant pas forcément tous nos domaines. Ce qui important, c'est que le conseil scientifique, confronté à toutes ces polémiques, a choisi de se saisir de cette question de lui-même. Il s'est concentré sur la question des phytosanitaires, qui est la plus controversée, avec le souci de comprendre ce qui amoindrissait notre crédibilité.
Si l'on regarde ce qui ressort de ce rapport, on en revient en réalité aux échanges que nous avons actuellement. La crédibilité est engendrée par la transparence et par la qualité de l'expertise. La déontologie fait également l'objet de beaucoup de questionnements. Nous nous devons donc de donner des garanties, d'ouvrir nos portes et nos dossiers – ce que nous faisons déjà largement – pour expliquer nos relations – ou d'ailleurs nos non-relations – avec les porteurs d'intérêts.

Envisagez-vous des débouchés concrets, sur le réglementaire ou législatif, ou encore via des changements internes ?
Ce sont plutôt des changements internes d'ordre procédural. Nous avons notamment été interrogés sur notre capacité à agir rapidement, sur le fait de ne pas avoir d'atermoiement dans certaines expertises un peu perçues comme des manœuvres dilatoires, là où nos scientifiques nous disent qu'ils ont besoin de plus de temps avec leur collectif d'experts. Nous sommes amenés à faire des propositions sur ce sujet. J'ai par ailleurs évoqué le renforcement constant de la déontologie ; nous avons peut-être encore quelques pistes en matière de transparence.
Je complèterai sur un des points clé de ce rapport qui est l'écart supposé entre l'expertise réglementaire d'une part et, d'autre part, les données provenant de la communauté scientifique. La phytopharmacovigilance vise précisément à réduire cet écart entre les deux, puisque nous nous nourrissons principalement de données académiques et de travaux scientifiques provenant des établissements publics de recherche ou des universités. Or, le rapport que vous évoquez ne valorisait pas du tout le travail de la phytopharmacovigilance, qui n'y est absolument pas présenté, ce qui nous a quelque peu interpellés. Je pense donc qu'il est essentiel de communiquer davantage sur l'existence de la phytopharmacovigilance et sur l'utilisation vraiment très intensive des résultats de la recherche académique dans le travail de l'Anses. Je vous confirme d'ailleurs que notre dispositif est unique en Europe, nous sommes les seuls à en bénéficier.
Le rapport souligne que la crédibilité de l'expertise scientifique est mise en doute lorsque les sujets sont politisés. Si le sujet n'est pas politique et, ainsi, pas porté par les médias, l'expertise n'est pas questionnée. Mais à chaque fois qu'un sujet sera médiatique, la crédibilité de l'expertise scientifique sera remise en cause. Par ailleurs, le comité de déontologie a souligné, dans son avis sur les maladies professionnelles, que le dispositif de pharmacovigilance était très peu financé, seulement via une taxe de 0,2 % sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché. Nous avons donc peu de moyens pour assurer cette pharmacovigilance, dont nous savons par ailleurs qu'elle remonte peu d'alertes.

Je me souviens de cette taxe établie à 0,2 % ; j'avais demandé un peu plus mais c'était un compromis. J'étais dans la majorité et il arrive que nous fassions des compromis. Cette phytopharmacovigilance est cependant une innovation unique en Europe ; elle permet de travailler in situ, in vivo, dans la vraie vie d'une molécule, de revenir sur une décision et de nourrir des expertises futures. L'Efsa a reconnu sa valeur ajoutée. Nos propositions incluront à un appel à l'élargissement de cette phytopharmacovigilance à l'échelle de l'Europe, pour que vous puissiez bénéficier de l'expérience d'autres pays.
Je terminerai sur les questions des effets cocktails et des coformulants, qui sont distinctes. Certaines personnes estiment que nous n'étudions pas l'effet des coformulants au même niveau que celui de la substance active. En outre, le produit et/ou la substance active n'agissent pas isolément d'autres molécules chimiques. L'effet de cumul entre substances peut provoquer des effets indésirables aujourd'hui mal mesurés. À ce sujet, pouvons-nous, ensemble et sereinement, plaider coupables en raison de l'absence de procédure, du caractère lacunaire de la recherche scientifique ? Qu'avez-vous déjà entrepris dans ce domaine, et que devons-nous encore lancer, pour être à la hauteur des enjeux qui sont devant nous ?
On a parfois l'impression, en effet, que circule l'idée que nous ne regarderions que la substance active, rien que la substance active, et jamais la formulation dans son ensemble. Or, ce n'est absolument pas le cas, évidemment. Faut-il cependant réaliser de l' in vivo sur la préparation complète au motif qu'il pourrait y avoir des interactions entre les composés ? Cette hypothèse est quelque peu théorique. Les toxicologues nous disent leur attachement à considérer avant tout la substance active, en raison de sa nature-même, qui est d'avoir une activité, un effet fongicide, herbicide ou insecticide. La formulation en masse est également portée par la substance active, d'où l'attachement premier à vérifier l'adéquation d'une substance active avec son utilisation ultérieure, et à identifier ses potentiels effets indésirables. Mais cela ne signifie pas que nous ne nous intéressons pas à la formulation – nous savons que la formulation pourra avoir des effets modulateurs divers et variés ; c'est d'ailleurs pour cela que nous avons mis en place cette évaluation zonale que j'évoquais.
Il est vrai cependant que nous ne disposons pas forcément de tests in vivo complémentaires pour la formulation dans son ensemble, excepté quelques tests très précis sur la toxicité aiguë, dont je vous avais déjà donné la teneur.
Mais nous conduisons des évaluations pour le produit complet volet par volet. Je précise d'ailleurs qu'une de nos unités, l'unité physico-chimie et méthodes d'analyse des produits réglementés (UPCMA), évalue les propriétés physico-chimiques de l'entièreté du produit, coformulants compris.
Le sujet, c'est que certains seraient désireux de connaître cette formulation globale. En l'état actuel des textes, nous sommes tenus par le secret des affaires, puisque nous avons un produit industriel. Il ne s'agit pas d'une position particulière de l'Anses. Quoi qu'il en soit, nous avons la composition complète et nous réalisons une évaluation des coformulants.
Je suis venue ici avec des exemples très concrets de produits que nous avons refusés très récemment parce que des coformulants ne convenaient pas. Nous les avons identifiés à la faveur des informations qui nous ont été données. Je pense que nous devons vraiment distinguer le débat sur l'évaluation des produits de celui sur des tests in vivo intégraux pour toutes les formulations – lesquels seraient, d'ailleurs, très mobilisateurs et donc très contestables sur le plan du bien-être animal.
Les toxicologues ont une approche graduée des formulations, en considérant les substances en fonction de leur niveau de danger – ils recourent pour cela à la base de données du règlement Reach. Il est sans doute possible de faire encore mieux, et des pistes d'amélioration méthodologiques existent. Mais je ne voudrais pas que vous partiez avec l'idée que le produit n'est pas examiné. Prenons l'exemple des génériques. Certaines personnes essaient de s'approcher des recettes des firmes pour proposer des génériques. Nous sommes tenus de vérifier si le produit est bien similaire à la référence revendiquée. Pour cela, nous devons bien vérifier l'intégralité de la composition, ainsi que sa proximité avec le produit de référence. S'il existe des différences, les propriétés ne seront plus tout à fait les mêmes, ce qui emporte des conséquences directes pour l'évaluation. Vous voyez donc que nous ne travaillons pas à l'aveugle sur des produits qui ne seraient pas complètement caractérisés.
Dans une synthèse sur les questions sensibles réalisée en 2021, le comité de déontologie avait recommandé de ne pas se cantonner à une approche substance par substance, où l'on observerait uniquement certaines substances qui sont dans l'environnement, en fonction de la surveillance qui en est faite par les services de l'environnement. Non seulement les substances sont bien plus nombreuses, mais elles peuvent en outre se transformer et devenir des métabolites, assez peu suivis dans le cadre de la surveillance environnementale. Dans les recherches scientifiques, il existe d'autres paradigmes que la simple analyse de l'effet du produit en fonction de sa dose sur sa cible. Il est en effet possible d'aller vers l'exposome, c'est-à-dire de considérer toutes les substances auxquelles les individus sont exposés au cours de leur existence, depuis le stade prénatal jusqu'à leur mort. Il est également possible de concevoir une règlementation qui ne serait pas établie par substance, en particulier dans des zones qui sont des points noirs en matière de contamination ; ce serait nouveau.
Sur le plan scientifique, je pense que l'Anses est très en pointe sur ce sujet des effets dits cocktails des substances. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du consortium Parc sur les méthodes d'évaluation des risques chimiques au sens large – pas uniquement des pesticides – nous sommes en charge de la question des effets cocktails. L'Anses est chargée de développer des méthodes sur ces sujets à l'échelle européenne. Nous l'avons d'abord fait dans le domaine alimentaire, en prenant en compte les métabolites de résidus dans les aliments. Nous le développons à l'heure actuelle dans le cadre de la phytopharmacovigilance, notamment avec notre partenaire Agrican, sur les effets sanitaires pour les travailleurs agricoles. Nous œuvrons sur un projet qui sera publié l'an prochain, où les effets cocktails auxquels sont exposés les agriculteurs sont mis en relation avec tous les types de cancers mesurés dans la cohorte Agrican.
Mais, dans les cohortes épidémiologiques en particulier, des données sur les expositions chroniques font défaut. Nous utilisons beaucoup la biosurveillance, c'est-à-dire les dosages internes des substances, urinaires, sanguins ou dans les cheveux. C'est souvent une mesure ponctuelle, à un moment donné. Nous aspirons à ce que les programmes de recherche menés au niveau national permettent des mesures répétées dans le temps pour les mêmes individus, de façon à avoir des données d'exposition beaucoup plus précises, que nous pourrions mettre en relation avec les effets sanitaires.

Le rapporteur, Monsieur Potier, soulignait à quel point la réforme législative de 2014 avait changé la donne ; je pense que celle-ci vous oblige à une robustesse particulière dans les décisions que vous rendez. J'ai eu l'occasion d'interroger l'Efsa sur le contexte européen. Des questionnements ressortent depuis plusieurs mois sur l'absence d'évaluation sérieuse de la toxicité de long terme, notamment des formulations représentatives considérées par l'Efsa. La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (cnDAspe) soulignait ainsi, en novembre 2022, que l'évaluation des risques opérée par l'Efsa ne correspondait plus aux exigences du règlement de 2009. Le directeur exécutif de l'Efsa, M. Berhnard Url, a également admis des problèmes de méthodologie pour évaluer ces fameux effets synergiques. Ces insuffisances ont finalement été soulignées par le fait que la Commission européenne a mis en place des ateliers pour tenter de corriger cette absence de méthodologie robuste pour évaluer les effets à long terme des formulations représentatives.
Madame Grastilleur, je me souviens d'un rendez-vous à l'Anses avec Monsieur le rapporteur Potier, le 25 novembre 2021, au cours duquel l'Anses avait admis reprendre les valeurs toxicologiques de référence données par l'Efsa concernant l'évaluation des produits, donc des formulations, et les appliquer sur les formulations que vous autorisez in fine. Or, au regard du contexte que je viens de rappeler, il y a donc de fortes chances pour que les valeurs de référence données par l'Efsa soient sous-estimées et qu'ainsi, le risque réel lié au produit ne soit pas évalué à sa juste valeur.
Considérez-vous que vos pratiques sur cette question spécifique de l'évaluation du risque à long terme des produits en formulation complète répondent aux exigences du règlement européen tel qu'il est écrit ? Si tel n'était pas le cas, quelles propositions seriez-vous en mesure de formuler afin de répondre à ces exigences ?
Je vais vous donner un exemple. Sans reprendre la litanie de tous les volets méthodologiques appliqués au produit, et je parle bien du produit, considérons la question des résidus par voie alimentaire, qui sont l'un des éléments du volet d'évaluation du produit. Nous examinons les expositions du consommateur au regard d'une valeur toxicologique robuste, avec une étude clé et un point critique à l'appui, et de multiples études derrière qui permettent de construire une valeur toxicologique de référence (VTR) qui est d'ailleurs évolutive à la hausse ou à la baisse. Nous parlons vraiment d'effets à long terme d'expositions cumulées, de doses journalières admissibles.
Je souhaiterais comprendre ce que l'on entend derrière le long terme. Certains évoquent un effet un peu holistique, qui d'ailleurs est réel, sur les questions de biodiversité. Mais le long terme est actuellement embarqué dans l'évaluation, y compris du produit.
Je reviens à l'idée que votre critique porte sur le fait de ne pas avoir de test, par exemple 90 jours sur des rats, par de nombreuses voies d'exposition, sur l'aspect in vivo. Le long terme peut toutefois être abordé par différents proxys tout à fait valables, y compris pour les scientifiques et les toxicologues.
On peut toujours améliorer les choses. Elles s'améliorent d'ailleurs graduellement, à mesure que la science évolue. En revanche, il serait contre-productif de laisser penser aux personnes qui s'interrogent sur les produits phytosanitaires que les expositions répétées ne sont pas intégrées dans l'approche réglementaire.
J'ai précisé que nous manquions de données de biométrologie sur le long terme dans les études épidémiologiques académiques. Ce n'est pas une carence propre à l'évaluation réglementaire. C'est bien ce thème qui doit être creusé si nous voulons aller vers l'exposome, et c'est ce vers quoi se dirige l'institut de santé publique de l'Inserm notamment. Il est vrai que, pour l'instant, nous retrouvons assez peu ce type d'information dans les cohortes épidémiologiques scientifiques nationales ou internationales. La marge de progrès porte donc plus, en l'occurrence, sur le monde de la recherche, notamment de la recherche épidémiologique.

Je pointais bien le fait que le règlement 2009 impose un certain nombre de cadres de référence à l'Efsa. Il est démontré que celle-ci ne répond pas, avec les méthodologies actuelles, à ce cadre de référence. Or, en novembre 2021, vous aviez mentionné vous appuyer sur les évaluations de l'Efsa qui, de ce fait, me semblent aujourd'hui chancelantes. En effet, lorsque l'on s'appuie sur une base qui n'est pas robuste, comment se prévaloir soi-même de la robustesse ? Je ne remets pas en cause le travail mené par l'Anses, mais vous vous appuyez sur un cadre qui ne me semble pas solide. De quelle manière le corriger ?
J'aurais besoin d'éléments plus précis pour pouvoir vous répondre sur ce sujet. Cette question me donne l'opportunité de rebondir sur nos interactions avec l'Efsa. Pour l'autorisation de la substance active, l'Efsa produit un rapport d'expertise. Nous en avons un exemple très concret avec le rapport glyphosate en ce moment. Derrière ce rapport, nous retrouvons des États membres rapporteurs avec toute la méthodologie scientifique associée pour l'appréciation de la substance active. Un État membre est rapporteur, un autre corapporteur. Ce travail préliminaire fait l'objet d'une revue par les pairs ; tous les autres États membres ont ainsi la capacité de le commenter. Il n'est donc pas correct d'affirmer que nous serions suspendus à une production de l'Efsa qui nous enfermerait et dont nous ne pourrions pas sortir. L'Efsa est chargée de coordonner une évaluation sur la substance active et sur une préparation représentative qui serait valable dans au moins un État membre. Une fois que la substance est approuvée – et l'approbation n'est pas de notre ressort – nous nous emparons de cette partie de l'évaluation, mais le travail reste à engager sur la formulation globale dont l'autorisation est demandée.
Nous nous appuyons effectivement sur des méthodologies européennes pour évaluer les impacts volet par volet : sur les abeilles, les riverains, les opérateurs, les travailleurs qui sont les plus concernés par le sujet des expositions, les consommateurs via les résidus, la qualité des eaux, les organismes non-cibles aquatiques, les vers de terre, les oiseaux, les mammifères. Cette appréciation est bien multi-volets. Pour ce faire, en effet, nous nous appuyons sur un cadre européen et sur des méthodologies européennes. Mais gardez à l'esprit que nous ne sommes pas emprisonnés par la méthodologie qui est évolutive, à la faveur de nouvelles données scientifiques disponibles. Nous sommes actuellement beaucoup questionnés sur notre capacité à évaluer certains matériels de réduction de la dérive. Dès lors que les données scientifiques existeront, nous expliquant comment la dérive diminue avec tel et tel matériel, nous les intégrerons dans notre évaluation.
Par conséquent, nous revendiquons l'utilisation des méthodologies européennes et nous contribuons largement à leur édification. Celles-ci sont de toute façon tout à fait évolutives. Nous ne sommes pas suspendus à une prise de position de l'Efsa et à des appréciations qui en découleraient en France, nous nous situons vraiment dans un travail coopératif qui se nourrit de données robustes, d'études robustes, qui essaient d'aller au fond des questions scientifiques, sur le sujet des expositions cumulées en particulier.

Vous soulignez que la substance active et la formule complète sont évaluées, au regard de l'exposition directe qui touche notamment nos agriculteurs, mais également de l'exposition cumulée, en tenant compte des résidus dans l'air, dans l'eau et dans notre alimentation. Pouvez-vous à présent nous expliquer le déroulement précis des premières étapes de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit, à partir du moment où l'industriel dépose sa demande à l'Anses ?
Pour pouvoir déposer une demande d'autorisation d'un produit, l'industriel doit auparavant s'assurer que les substances actives incorporées dans son produit sont approuvées à l'échelle européenne. Lorsque nous recevons le dossier, celui-ci fait l'objet d'une réception administrative – il ne s'agit à ce stade en aucun cas d'un pointage scientifique ; les pièces minimales nécessaires sont pointées. Les évaluateurs s'emparent ensuite de la totalité du dossier et fixent leur calendrier. Le dossier est examiné par le collectif d'experts qui valide des conclusions, lesquelles sont transmises à nos collègues chargés de mettre les autorisations en forme. L'autorisation qui en découle est alors transférée à la firme.
Selon la complexité du dossier, une fois les conclusions éditées définitivement, signées et donc irrévocables, elles sont envoyées soit en même temps que la décision à la firme, soit de façon disjointe.
S'agissant de nos interactions avec les firmes, sur les gros dossiers, au moment du prédossier, il est possible d'observer une phase de présoumission, très codifiée, où l'industriel peut expliquer son projet. Nous faisons alors un inventaire des requis obligatoires de la législation au regard de sa demande. C'est le moment de l'interaction. Il ne s'agit pas du tout de le conseiller, mais de lui indiquer que s'il a la volonté de mettre sur le marché un type de produit, l'intégralité de certains volets est nécessaire à la présoumission, d'autres ne le sont pas. Une fois la présoumission passée, le processus est celui que je vous ai indiqué, avec la réception du dossier, le pointage administratif et le passage en évaluation, de façon disjointe du traitement de la décision.
Les délais sont très variables selon les produits. Nos efforts portent beaucoup sur le biocontrôle, puisqu'il existe une stratégie nationale en ce sens ainsi qu'une volonté de renouveler l'arsenal thérapeutique avec des produits de ce type. Pour le biocontrôle, nous avons une médiane de traitement d'un an, qui pour nous est vraiment performante parce que ce ne sont pas forcément des dossiers simples. Nous avons rencontré des difficultés car nous avons eu affaire à de nouvelles substances actives, notamment les phéromones des lépidoptères. Le biocontrôle n'implique pas forcément une innocuité par principe.
S'agissant des autres produits hors biocontrôle, nous sommes parfois simplement dans une situation de reconnaissance mutuelle, qui consiste à vérifier un dossier pour un produit déjà disponible dans un autre État membre de notre zone. En dehors de cette situation, les dossiers sont souvent traités sur deux années, les demandes de renouvellement étant souvent plus compliqués que les demandes de nouvelles autorisations de mise sur le marché.

Je tiens à préciser qu'au-delà de ma fonction de député, je suis agriculteur, ce qui va peut-être orienter mes questions. Je recherche un équilibre délicat entre production et protection. Je m'interroge sur certains des points que vous avez évoqués. Je pense qu'un produit phytosanitaire a effectivement un impact potentiel sur la santé et sur l'environnement, mais il a également une qualité spécifique, soit insecticide, soit herbicide, soit biocide. Est-ce que votre évaluation porte uniquement sur la dimension environnementale et sanitaire ou est-ce que vous évaluez également les qualités intrinsèques du produit au regard de l'objectif de protection visé ? On peut protéger l'environnement en retirant un produit mais aussi en autorisant un produit mieux-disant que ceux actuellement utilisés. Comment prenez-vous en compte cette dimension dans vos évaluations ?
À l'inverse, si on interdit on laissant les agriculteurs sans solution, on va favoriser la production à l'étranger avec des méthodes souvent beaucoup plus agressives ; alors je n'ai pas l'impression que nous aurons fait beaucoup avancer la cause de l'environnement. Dans le cadre de mes activités agricoles, je multiplie les semences ; il existe des autorisations spécifiques sur des usages très faibles. La multiplication de semences de choux-fleurs ne doit représenter que quelques hectares en France. Pour autant, on doit passer par un processus d'homologation spécifique, produit phytosanitaire par produit phytosanitaire, culture par culture et usage par usage. Le produit est homologué pour tel insecte du chou-fleur. La multiplication administrative fait que des dossiers ne sont pas demandés par les industriels ; en conséquence, certaines solutions ne sont pas mises à disposition des agriculteurs, en particulier lorsqu'elles concernent des cultures anecdotiques qui, au demeurant, apportent une forme de diversité. Ne pourrait-on pas fluidifier les choses ?
Je prendrai l'exemple des mycotoxines. Lorsque nos cultures sont matures, je pense notamment au blé ou à l'orge, si, au mois de juin, les conditions sont un peu humides, des champignons se développent sur les grains et produisent des toxines appelées mycotoxines qui, pour certaines, peuvent être extrêmement nocives. Dans vos évaluations, vous livrez-vous à des comparaisons entre l'impact d'un fongicide et ses conséquences, si la culture n'est pas traitée, et, à l'inverse, l'impact de l'absence de fongicides lorsque l'on traite la culture ? Il me semble que dans une approche globale, il faudrait mettre tous ces éléments en perspective.
Enfin, la bouillie bordelaise est un produit ancien, largement utilisé en agriculture biologique. J'ai toutefois l'impression que l'accumulation de cuivre dans le temps a un impact majeur sur l'environnement. Comment cette substance considérée par certains comme quasi naturelle est-elle évaluée du point de vue de la réglementation ?
J'ai l'impression que la déontologie est parfois une question de rapports de force entre des positions qui peuvent être politiques : privilégie-t-on plutôt la production ou la protection de l'environnement ?
Je vous remercie d'avoir posé ces questions qui permettent de revenir sur un sujet peu abordé, qui est cependant au cœur de l'audition : le rôle de l'AMM, ce qu'elle porte et ne porte pas. Je pense que votre question est tout à fait essentielle à cet égard. L'AMM est un verrou de sécurité parmi de nombreux outils de gestion des phytosanitaires ; c'est également une règle de loyauté d'accès au marché pour les produits. Le verrou est très clair : l'AMM doit garantir le fait que le produit répond à des critères de sûreté qui sont dans la législation, et à des critères d'efficacité au regard du danger à combattre. Votre exemple sur la mycotoxine est extrêmement bon. Nous sommes effectivement face à toutes ces questions, notamment d'ochratoxines, voire d'ergot, qui revient très fortement en ce moment. L'AMM résulte d'une démonstration que le produit va répondre aux critères de sûreté et qu'il permet bien d'atteindre l'objectif affiché aux doses et conditions d'emploi prescrites : par exemple, le traitement de la cercosporiose, partie aérienne sur telle production. C'est très précis et le produit doit être efficace. Nous disposons également de tests terrain, de démonstrations efficacité à l'appui. Nous en parlons assez peu mais c'est là un gros travail pour nos collègues. Si l'efficacité n'est pas confirmée, nous refusons le produit.
En revanche, l'AMM, ne tient pas compte de l'arsenal thérapeutique à disposition par ailleurs ; elle ne tient pas compte du fait que, peut-être, il faudrait avoir un produit en particulier parce qu'un bioagresseur devient omniprésent. Et, lorsqu'on interdit des produits, un report automatique sur d'autres produits plus restreints en nombre s'opère, ce qui augmente mécaniquement la présence de certains résidus. Tous ces enjeux ne sont pas pris en compte dans le dispositif de l'AMM, ce n'est pas ce que prévoit la législation.
Un effort complémentaire de construction des itinéraires de traitement est déployé par ailleurs. Je pense à Ecophyto en particulier ou à d'autres plans gouvernementaux comme le plan d'anticipation du retrait de certaines substances actives. L'AMM ne peut pas tout faire et ne fait pas tout. Je pense qu'elle ne fera jamais tout. En l'état actuel de la législation, elle est vraiment une garantie d'accès équitable au marché pour les firmes, l'accès à un produit efficace pour l'agriculteur et une garantie de sécurité pour tous ceux qui peuvent être exposés au produit. Par ailleurs, la logique du plan Ecophyto est de réduire les utilisations. Mais l'AMM n'a pas vocation à réduire des utilisations. Nous nous situons plutôt dans une logique d'agriculture raisonnée, de bonne utilisation d'un itinéraire de traitement qui se tienne au regard de la surveillance et des dangers réellement présents au champ.
Des plans de surveillance et des plans de contrôle des administrations existent sur les mycotoxines dans les aliments. Nous sommes très mobilisés sur cette thématique à l'agence. Une étude alimentation totale a lieu régulièrement et calcule les expositions à la plupart des mycotoxines présentes dans l'alimentation. Dans la prochaine étude, qui vient de se terminer et sera publiée d'ici un an et demi, nous ferons des évaluations de risques à la fois pour les consommateurs réguliers de produits d'agriculture biologique, pour des consommateurs occasionnels et pour des non consommateurs, en vue de pointer des différences d'exposition aux mycotoxines du fait des différents modes de traitement. Il s'agit donc d'un sujet d'étude prioritaire pour nous.
La déontologie consiste en un corpus de règles professionnelles pour les experts, de façon à ce qu'ils soient en mesure de bien répondre aux interrogations dans le mandat qui leur est confié et d'apporter leurs connaissances de façon non biaisée et transparente. La réglementation française et européenne fait que l'évaluation demandée aux experts concerne l'impact d'un produit sur la santé et sur l'environnement dans un contexte de fortes incertitudes qui justifie qu'on ait recours à cette expertise. On pourrait, de la même façon, tout à fait concevoir une expertise socio-économique sur ces produits phytosanitaires, mais cela ne correspond pas à ce qui est demandé à l'Anses aujourd'hui.

Notre commission d'enquête porte sur la réduction – ou plutôt le questionnement sur la non-réduction – des produits phytosanitaires. Or, dans le cadre de la procédure d'AMM, l'Anses a une approche produit par produit et, parfois, la réduction d'un produit peut induire la surconsommation d'un autre. Ne pensez-vous pas que cette approche produit par produit contribue à expliquer la non-réduction de l'usage global des produits phytosanitaires ?
C'est vrai que ce n'est pas la procédure d'AMM en elle-seule qui va induire la réduction des usages qui doit être recherchée par d'autres voies : la biosurveillance au champ, le traitement le plus adapté possible, l'agriculture de précision – toute une série de dispositifs qui ne sont pas forcément dans le champ de l'autorisation.
Je le répète : l'enjeu pour nous est de garantir la sécurité et l'efficacité d'un produit pour un usage revendiqué. Je trouve l'exemple récent de l'herbicide S-métolachlore est intéressant de ce point de vue. On nous a dit qu'en interdisant ce produit, on allait mettre en difficulté certaines cultures, qui pourraient être confrontées à une résurgence du datura, une plante toxique. Mais si le produit ne passe pas la barre des critères de sécurité et d'efficacité, peu importe pour nous qu'il y ait ce besoin vis-à-vis du datura : il n'arrivera pas sur le marché.
On peut réduire les utilisations par le levier de l'AMM, mais ce n'est pas suffisant. Ce sont ici des questions partiellement disjointes : la réduction des utilisations des produits phytosanitaires et le renforcement des AMM ne sont pas des vases communicants.
Je pense que vous soulevez ici une question très importante, qui commence tout juste à être étudiée par le conseil scientifique et technique du plan Ecophyto ; il lui faudrait des moyens supplémentaires – moyens humains en particulier – pour pouvoir le faire convenablement. Nous n'aurions pas pu répondre à cette question il y a cinq ou six ans, mais nous disposons désormais de données, avec les bases de données de vente, avec lesquelles il serait possible de réaliser cette analyse de substitution entre substances.

Je suis d'accord avec le rapporteur : cette audition est majeure pour notre commission d'enquête. Je souhaiterais revenir sur la question du rôle donné à l'Anses par la loi de 2014. J'ai rédigé une proposition de loi afin de revenir à la situation antérieure à 2014. Madame Grastilleur, vous n'avez fait que confirmer ce qu'avait déclaré M. Vallet lorsqu'il était venu devant la commission des affaires économiques, qui était à mon sens très éclairant. Personne ne remet en cause le travail scientifique réalisé par l'Anses. Ce qui est remis en cause ne dépend pas de l'Anses mais du législateur : c'est le rôle qu'on lui a donné. La crédibilité de l'Anses est remise en cause sur le terrain par ce sentiment qu'elle est un peu dans sa tour d'ivoire et fait des choix sans avoir conscience des conséquences. Ce n'est pas de votre faute cependant, car le législateur vous a donné cette compétence. Je reprends vos propos, Madame Grastilleur, vous n'avez « pas de latitude politique pour aménager la décision » : c'est là qu'est la difficulté. Aménager la décision, ça ne veut pas dire faire plaisir à des firmes pharmaceutiques, phytopharmaceutiques ou à un lobby agricole. Cela veut dire tenir compte de l'impératif de souveraineté alimentaire – préoccupation du reste partagée par l'ensemble des forces politiques. Il s'agit de protéger les citoyens, Monsieur Prud'homme.
Je n'ai pas une position caricaturale ; il convient de faire des choix à certains moments. Je comprends tout à fait que certaines molécules soient retirées du marché parce qu'elles ont un impact sur la santé humaine ou sur l'environnement. Monsieur le rapporteur souhaitait élargir au niveau européen. Gardez à l'esprit que lorsque l'Allemagne décide de garder des centrales à charbon, elle est parfaitement consciente de l'existence d'un impact sur la santé humaine. Lorsque la France décide de relancer son parc nucléaire, elle est parfaitement consciente des risques inhérents à l'industrie nucléaire. Il faut avoir cette capacité de choix politiques pour bien prendre en compte l'ensemble des dimensions autour de l'usage des produits phytosanitaires : les impacts sur l'environnement et sur la santé humaine, mais également sur l'activité agricole et économique et sur la souveraineté alimentaire. Si nous nous focalisons exclusivement sur les questions environnementales ou de santé humaine, nous pourrons demain mettre un terme à l'agriculture française.
Je relève en outre un problème de démocratie ; le peuple français est souverain, c'est dans la Constitution ; il exerce sa souveraineté par des représentants légitimement élus. On ne doit pas laisser à l'administration des choix qui sont éminemment politiques. Comprenez bien que je ne remets pas en cause votre travail, mais uniquement les choix du législateur. Je ne tiens pas à apparaître comme le représentant d'un lobby agricole ou même de celui de l'industrie phytopharmaceutique, mais nous devons nous donner les moyens de la souveraineté alimentaire. Nous pouvons faire des sacrifices, il faut pouvoir avoir le choix.

Madame Grastilleur, vous souhaitez peut-être répondre. De quelle manière prenez-vous en compte les besoins des filières ?
Ce que vous avez retenu de mon propos introductif est juste : la latitude politique est absente. Mais, comme je l'ai dit, cela ne tient pas au signataire – le directeur de l'Anses ou le directeur de la direction générale de l'alimentation – mais au contenu même du texte règlement européen qui nous oblige tous. Tout écart au texte emporte des conséquences pénales très directes. Quand le directeur général de l'alimentation signait les autorisations, le texte qui s'opposait à lui était le texte qui s'oppose à nous actuellement. Nous sommes conscients que les filières ont des besoins ; nous comptons dans nos équipes des agronomes qui étudient ces questions.

Nous connaissons la position de l'Efsa sur le glyphosate. Nous avons appris hier que l'Union européenne repartirait pour une prolongation de l'autorisation de dix ans. Quel sera le positionnement de l'Anses sur cette question ?
Nous n'avons pas de positionnement parce que nous ne sommes pas décideurs pour l'autorisation de la substance. Un travail collaboratif a été engagé entre quatre États membres sur la partie du rapportage de l'évaluation des risques liés au glyphosate. Le rapport préparatoire remis à l'Efsa a été soumis à consultation publique – consultation absolument massive avec des dépôts de littératures scientifiques diverses très importants –, et revu par les pairs des États membres. L'Anses a fait son travail dans le cadre de la partie collaborative de l'expertise.

Pouvez-vous vous autosaisir d'un dossier en cas de doute sur un produit pour lequel une autorisation de mise sur le marché a déjà été délivrée ? Qui peut vous saisir ? D'autre part, vous avez souligné les carences de la recherche épidémiologique pour mieux prendre en compte l'exposome, donc le lien avec le vivant. De telles données permettraient de conforter la confiance, dans un contexte où nous ignorons beaucoup de choses. Que préconisez-vous à ce sujet ?
Dès qu'un risque est soulevé, il doit évidemment être caractérisé par nos soins, par modélisation calculée ; et nous avons la capacité juridique, en vertu de la législation européenne, pour ouvrir un dossier sur un produit en cours d'autorisation. Nous nous sommes déjà servis de cet instrument : il s'agit de l'article 44 du règlement. Notez d'ailleurs que l'Anses est obligée d'agir sur l'autorisation pour que le produit redevienne conforme en cas de problème. L'instrument juridique existe et vaut pour la France comme pour tout autre État membre ayant délivré une autorisation. Nous nous en servons de façon régulière en cas de nécessité, lorsqu'il y a des indications de risques.
Toutes les personnes qui nous saisissent habituellement peuvent nous saisir dans ce cadre : les entités représentées à notre conseil d'administration, les associations de défense de l'environnement agréées, la représentation syndicale, les ministères de tutelle. Si cela apparaît nécessaire – preuves à l'appui – nous rouvrons le dossier et faisons une mise à jour de l'autorisation, ou retirons cette autorisation s'il n'est plus possible de continuer à utiliser le produit sans risque inacceptable.
Il y a quelques mois, nous avons réalisé un rapport sur l'exposome qui émet un certain nombre de recommandations concernant la recherche épidémiologique. Nous encourageons fortement les équipes. Il est possible de financer partiellement des cohortes, ce que nous faisons actuellement avec la cohorte Agrican. Nous pouvons également apporter des appuis à certaines cohortes qui étudient l'exposome, comme nous le faisons avec la cohorte Elfe, une cohorte mère-enfant – nous avons en effet considéré que toutes les questions de perturbation endocrinienne étaient prioritaires pour nous, pas uniquement en lien avec les produits phytosanitaires. Nous leur avons permis de calculer des indicateurs d'exposition aux perturbateurs endocriniens pour les femmes enceintes, et donc les fœtus. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour développer l'activité exposome dans le domaine épidémiologique. Mais nous ne sommes pas le ministère de la recherche ; c'est à ce ministère qu'il revient de financer des cohortes et de développer les activités sur l'exposome dans les différentes cohortes.
J'ai précédemment parlé d'ignorance. En réalité, l'imprégnation de l'environnement par les substances artificielles est très peu mesurée de façon routinière. Dans le domaine de l'eau, par exemple, nous mesurons les substances utilisées, mais pas leurs métabolites, ou très rarement.

Je vous posais précédemment une question sur les évaluations et les expertises ex ante. Je souhaiterais à présent aborder l' ex post. La semaine dernière, nous avons assisté à l'audition du réseau Atmo et de votre collègue M. Ohri Yamada. Nous avons appris l'absence totale d'études toxicologiques sur l'exposition aux pesticides par la voie respiratoire, l'absence de valeurs réglementaires pour la présence de ces molécules dans l'air. M. Yamada expliquait qu'il s'attelait à identifier des alertes ensuite transmises au pôle des produits réglementés, chargé de prendre des mesures concrètes et d'engager des actions. Nous avons actuellement des alertes ex post avec les clusters de cancers pédiatriques à Saint-Rogatien ou à Sainte-Pazanne. Quelles actions ont été mises en œuvre pour prendre en compte ces alertes ? M. Volatier soulignait qu'il était en mesure de diligenter des études sur ces questions de pharmacovigilance. Il me semble en effet que la mission de l'Anses est de protéger la santé des Français. Je pense que nous sommes véritablement au cœur de vos missions.

La Commission européenne doit rendre une décision avant le 31 octobre sur le prosulfocarbe, qui est une substance particulièrement volatile. Pouvez-vous nous apporter des précisions à ce sujet ?
J'allais prendre cet exemple. Je pense que M. Ohri Yamada a très bien exposé la situation, notamment sur la partie ex post. Il est vrai que la surveillance est faible et que les valeurs réglementaires dans l'air n'existent pas, ce qui ne nous rend pas incapables de faire des évaluations de risques ex post, parce que les valeurs de sécurité toxicologique dans l'air par inhalation existent. Je ferai d'ailleurs très aisément le lien avec le prosulfocarbe et les évaluations de dossiers. Quand on regarde l'exposition par l'air au prosulfocarbe, notamment par voie inhalée ou cutanée, nous disposons de valeurs toxicologiques de référence, qui sont des valeurs d'exposition chronique, dérivées de l' in vivo sur le rat 90 jours. Nous pouvons donc nous servir de cette valeur toxicologique, valeur de sécurité, établie ex ante pour les besoins de l'évaluation de dossiers, afin de réaliser des évaluations ex post des risques. C'est très important. Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion entre l'absence de valeur réglementaire, qui est sans doute un vrai sujet, et l'absence de capacité à juger de la situation sanitaire.
Nous avons émis des recommandations et mis en place une campagne exploratoire air avec Atmo. Nous sommes favorables à la mise en place d'une surveillance régulière de l'air à une échelle plus grande que ce que font les Aasqa localement et aspirons surtout à une harmonisation des pratiques. Par ailleurs, nous étudions plus précisément la question de l'exposition des riverains. Avec Santé Publique France et l'Inserm, nous avons mis en place l'étude Géocap-Agri qui a apporté des premiers résultats sur le cancer de l'enfant, avec un financement de la phytopharmacovigilance. Après la présentation des premiers éléments de résultats au comité de suivi l'an dernier, il a été décidé de lancer un travail plus fin sur les cocktails de substances.
Mais Géocap-Agri est seulement une étude géographique ; elle porte sur les expositions en proximité des cultures et ne permet pas de conclure de manière générale sur les effets des produits phytopharmaceutiques. C'est une première étape. Il existe des facteurs de confusion possibles ; nous ne pouvons pas nous baser sur une étude géographique. En épidémiologie, l'étude géographique, ou l'étude écologique, constitue le plus bas niveau de preuve. Au-dessus, il y a l'étude de cas-témoin, la cohorte puis la méta-analyse.
Dans le cadre de Geocap-Agri, nous observons un signal lié à une association statistique entre proximité des vignes, intensité de la présence de vignes dans la culture et certains cancers de l'enfant. Ces constats nécessitent de mener une investigation à laquelle nous sommes en train de réfléchir avec l'équipe du registre des cancers de l'enfant. Il n'est pas envisageable cependant de prendre des décisions à ce stade, nous n'avons pas d'éléments suffisants. L'expertise collective Inserm souligne bien, d'ailleurs, que, sur la question des riverains, l'évidence épidémiologique est faible. Nous avons besoin de davantage de données et de résultats. C'est aussi pour cette raison que nous mettons en place l'étude PestiRiv, avec Santé Publique France, sur l'exposition des riverains. Elle inclut à la fois une biosurveillance menée par Santé Publique France, avec des dosages urinaires ou des cheveux, et des mesures environnementales, qui sont de notre ressort, pour essayer de voir si une surimprégnation est observée et en vue d'en déterminer l'origine. L'objectif sera d'en tirer des conclusions en vue de réduire les expositions. Nous avons terminé les prélèvements sur le terrain pour cette étude, malgré le Covid-19. Nous sommes actuellement dans la phase des analyses chimiques ; elle prend du temps car plusieurs centaines de personnes ont participé et des dizaines de substances sont concernées. Notre objectif reste une publication fin 2024 ou au premier semestre 2025.
Ce sujet de la contamination de l'air nous importe beaucoup. Nous pensons qu'il serait aussi important de mieux appréhender ce que représente l'air par rapport aux autres sources et voies d'exposition. À ce stade, nous considérons que l'exposition par la voie alimentaire est la plus importante, les concentrations dans les aliments étant de l'ordre du microgramme par kilo, voire de la dizaine de microgrammes ; dans l'air, elles sont de l'ordre du nanogramme par mètre cube, voire de la dizaine, parfois très exceptionnellement de la centaine de nanogrammes. Les ordres de grandeur sont donc différents. Mais nous avons besoin de mieux évaluer ce que représente l'exposition par voie aérienne. Il faut poursuivre et amplifier les travaux sur ce sujet.

Je souhaiterais obtenir une précision sur l'échange qui vient d'avoir lieu autour de la problématique des pesticides dans l'air. Pensez-vous qu'un suivi permanent de ces pesticides devrait être mis en œuvre ? Atmo réalise des mesures ponctuelles depuis de nombreuses années. Nous disposons même de mesures consolidées depuis 17 ans. Je rappelle qu'il y a quelques années, le gouvernement avait décidé de lancer une étude exploratoire pendant un an sur les pesticides. Je pense que c'est problématique de ne pas avoir de normes réglementaires dans l'air. Je comprends ce que vous dites au sujet de la concentration plus importante des polluants dans les aliments. Mais n'oublions pas que le volume d'air inspiré et expiré tous les jours par un être humain est important : selon l'activité, il est de 12 000 à 15 000 litres d'air. Même s'il s'agit de nanogrammes, par cet effet volume, cela peut être important. Ne pensez-vous pas qu'un suivi permanent des pesticides dans l'air serait nécessaire pour parvenir à établir des seuils à ne pas dépasser ? Ce suivi existe pour les oxydes d'azote, pour différents types de composants organiques ou volatils, pour des particules fines de différentes tailles.

Dans mon propos introductif, j'ai évoqué le fait que par essence, un produit phytosanitaire n'est pas sain pour l'environnement et pour la santé. Se pose la question importante de la fixation des valeurs toxiques de référence. Qui les fixe ? Travaillez-vous avec le ministère de la Santé sur ce sujet ?
L'Anses a établi un rapport à l'issue de la campagne exploratoire, qui recommande la mise en place d'une surveillance permanente de l'air.
Des études toxicologiques viennent à l'appui des valeurs toxicologiques de référence (VTR). Si je prends l'exemple actuel de nos travaux sur les SDHI, nous avons constitué un groupe de toxicologues ad hoc en vue de réviser les VTR. Au moment de l'examen du dossier, nous opérons au sein de notre entité, avec le collectif qui correspond, sur la base des propositions d'études et de la qualification d'un point critique dont on peut dériver la VTR. Cette valeur n'est pas gravée dans le marbre cependant.
On nous fait souvent remarquer que nous sommes en divergence avec telle structure, ou qu'une entité ne met pas en avant le même point qu'une autre. Je reviens sur ce que disait M. Volatier au sujet de l'étude Géocap-Agri. Il a précisé que nous étions sur une étude terrain géographique, soit le plus faible niveau de preuves. Je comprends parfaitement la réaction que peut avoir chacun face aux résultats parfois alarmants d'une étude. Mais l'examen scientifique impose une méthodologie, un regroupement de toutes les études qui semblent dire plus ou moins la même chose et un examen en fonction des niveaux de preuve. Je pense que nous devrions être plus pédagogues sur ce point.

Abordons dès à présent ce que pourrait être l'ordre du jour d'une prochaine réunion. Nous n'avons pas pu aborder la question de l'articulation de vos missions avec celles de l'Efsa. La répartition zonale pour la gestion des AMM est-elle encore pertinente, au regard des différences d'expertise et de déontologie des différentes agences ? Par ailleurs, la séparation entre l'autorisation des substances et des produits est-elle encore pertinente ? Ne faudrait-il pas porter une ambition européenne d'unification des procédures ? Il y a aussi la question du travail d'influence exercé par l'Anses et par le Gouvernement français à l'échelle européenne. Nous avons porté ces questions avec M. Loïc Prud'homme lorsque nous vous avions rencontré avec M. Joël Labbé.
Par ailleurs, des questions très précises d'identification des coformulants ont été posées par Secrets toxiques ; l'association Pollinis en pose d'autres qui ont d'ailleurs été formulées dans cette assemblée et méritent des réponses précises. Nous risquerions, à défaut, de rester dans un sentiment d'insatisfaction.
Je soulève enfin une question qui relève plus de philosophie, de la science et de la démocratie. Madame Grastilleur, vous avez abordé le sujet du glyphosate. Un affrontement se prépare car, malgré toutes les expertises scientifiques, la question n'est pas tranchée. Nous demandons aux agences d'aller au bout de la complexité et de la complétude des études scientifiques, des vérifications mais, lorsque le résultat ne nous convient pas, nous prenons l'argument d'études spécifiques qui plaident en sens contraire, bien qu'avec un moindre niveau de preuve. Sur le plan intellectuel, c'est paradoxal : nous recherchons finalement du spécifique.
Nous pourrons enfin aborder une question encore plus vertigineuse : au nom de l'incertitude, nous pourrions en arriver à interdire tous les produits puisqu'on ne sait pas tout de leurs effets. Dans l'absolu, nous pourrions donc décider de ne plus délivrer une seule AMM. Nous sommes néanmoins amenés à délivrer des autorisations avec les données scientifiques disponibles, tout en sachant que tous les compartiments n'ont pas été explorés.
Acceptez-vous ce prochain rendez-vous pour poursuivre notre dialogue ? C'est une politesse car, dans une commission d'enquête, vous répondez à une convocation…
Mon propos ne sera pas forcément conclusif parce que le débat reste complètement ouvert. Je pense que toute décision politique se fait en situation d'incertitude, avec la connaissance du moment. Ce n'est donc certainement pas propre au phytosanitaire, il ne faut pas l'oublier. Il s'agit bien, pour nous, d'expliciter le niveau d'incertitude et de preuve de ce que nous avançons. Le fond de science et les connaissances évoluent rapidement. Le temps de notre audition, nous prenons connaissance de nouveaux points que nous ne connaissions pas. La vérité d'un jour ne sera peut-être pas celle de demain. Il arrive que l'incertitude soit exploitée dans un sens ou dans un autre, en fonction d'une intention politique.
Puis la commission entend lors d'une table ronde réunissant des agences de l'eau :
– M. Guillaume Choisy, directeur général de l'Agence de l'eau Adour-Garonne ;
– M. Martin Gutton, directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ;
– Mme Sandrine Rocard, directrice générale de l'Agence de l'eau Seine-Normandie ;
– M. Nicolas Chantepy, directeur général adjoint de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.

Après l'audition des représentants de l'Anses, nous poursuivons les travaux de notre commission d'enquête sur les produits phytosanitaires, avec l'audition d'une autre catégorie d'acteurs majeurs dans notre politique de réduction de l'usage des produits phytosanitaires, les agences de l'eau. Les agences de l'eau sont aux deux bouts de la chaîne. En aval, elles constatent les impacts indirects nocifs des produits phytosanitaires, en particulier sur la qualité de l'eau, qui relève, entre autres, de leurs responsabilités. Et en amont, elles sont chargées, dans le cadre du plan Écophyto, de conduire diverses actions en faveur de la réduction des usages et des risques liés aux produits phytosanitaires, notamment à destination des agriculteurs. Je crois d'ailleurs que votre action en la matière va bien au-delà de ce qui est officiellement financé par le plan Écophyto, par le canal de la redevance pour pollution diffuse, la RPD.
Vous allez donc pouvoir aujourd'hui nous exposer quelles sont exactement vos missions, quels types d'actions vous entreprenez, avec quels moyens et quels résultats, mais aussi quelles sont les difficultés et limites auxquelles vous êtes confrontés.
Nous avons convié à cette table ronde quatre agences de l'eau qui couvrent des bassins assez divers en termes de géographie, de climat et d'assolement. Cela nous permettra aussi d'apprécier la diversité des problématiques rencontrées selon les territoires. Il s'agit des agences de l'eau d'Adour-Garonne, Loire-Bretagne, Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée-Corse. Je précise qu'il y a six agences de l'eau sur le territoire métropolitain. Nous aborderons les spécificités de l'outre-mer lors d'une journée dédiée, au mois d'octobre.
Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de vous être rendus disponibles pour cette table ronde. Je vais à présent vous laisser la parole. Auparavant, je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».
(Mme Sandrine Rocard et MM. Guillaume Choisy, Martin Gutton, Nicolas Chantepy prêtent serment.)
Je vous présente en quelques mots le bassin de Haute-Garonne, un bassin du Sud-Ouest qui représente 23 % du territoire métropolitain. Ce bassin comprend 128 000 kilomètres de rivières, avec une densité de la population relativement faible puisque que 77 % du territoire est en zone de revitalisation rurale (ZRR). La moitié de ces masses d'eau sont en bon état. La spécificité de notre bassin est que près de deux tiers de l'alimentation en eau potable se fait par les rivières, ce qui induit une dépendance plus forte à la fluctuation de la qualité et de la quantité des eaux au sein du territoire.
Les départements et le territoire sont très agricoles. Ils accueillent un tiers des agriculteurs français sur des exploitations de taille plutôt modeste, autour de 40 hectares, avec en revanche une faible valeur ajoutée produite par rapport à l'ensemble de ferme France. Je crois que nous représentons à peu près 18 % du produit intérieur agricole français.
Les pesticides suscitent une question prégnante, qui a fait l'objet d'un travail de concertation. Je pense que nous ne sommes aujourd'hui pas sans solution : nous avons expérimenté des solutions qui demanderont d'être massifiées si nous voulons tendre vers la qualité de l'eau. Le bilan des actions conduites est ainsi mitigé. Ce n'est probablement pas satisfaisant en termes de résultats, mais il faut avoir en tête que ce sont des changements qui prennent du temps.
Les masses d'eau en déficit qualitatif sont, pour 40 % d'entre elles, impactées par des problèmes de qualité dus aux rémanences de pesticides.
La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est aussi le résultat des politiques Pisani. Notre politique de reconnaissance de l'agriculture est probablement un peu singulière par rapport à d'autres pays. Elle est largement fondée sur la performance, notamment celle de l'élevage laitier, en termes de production, et la performance à l'hectare. Dans notre bassin, le travail mené avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, les régions et le centre national de la recherche scientifique (CNRS) montre que lorsque l'on baisse l'impact global des pesticides sur un territoire, on ne défavorise pas économiquement les exploitations. Quand ces dernières réduisent leur usage de pesticides de 25 %, elles augmentent leur rentabilité d'exploitation. Il faut cependant adopter une vision pluriannuelle et pas forcément annuelle.
C'est un point important. Les fermes Dephy ou le plan Écophyto l'ont aussi démontré. Nous devons réussir à sortir de ces choix-là, qui sont des choix politiques. Il faut regarder de quelle manière on peut arriver à une adéquation entre les besoins des filières et ce que peut absorber l'environnement – et sur un bassin comme le nôtre, ce ne sont pas tant les fongicides que certains herbicides qui posent problème. Un travail de filière et de mise en cohérence de la politique agricole commune (PAC) et de la directive-cadre sur l'eau doit être conduit, avec des moyens financiers supérieurs à ce qu'ils ont été jusqu'à aujourd'hui. La PAC représente 9 milliards d'euros par an et le plan Écophyto, seulement 70 millions d'euros. La mobilisation et les résultats sont peut-être aussi à la hauteur de ce que l'on a mobilisé par le passé.
Pour obtenir des résultats, il faut se donner le temps, quand on massifie des politiques de filières. Dans l'aire d'alimentation des captages de Coulonges, qui alimente Rochefort et La Rochelle en eau, nous avons baissé de 25 % le taux de nitrates au cours des cinq dernières années. Nous avons stabilisé l'impact des phytosanitaires, notamment des herbicides qui nous posaient problème sur ce territoire. Nous y parvenons grâce à des politiques fortes et concertées menées avec l'ensemble des coopératives, des acteurs économiques, des agriculteurs, des collectivités locales. Aujourd'hui, plus de mille exploitations dédiées au cognac fonctionnent sans herbicide.
Nous avons passé cette année plusieurs auditions auprès de la Banque mondiale, avec le Medef et des acteurs économiques. Je pense qu'il ne faut pas manquer ce virage, en France et en Europe, qui emporte des potentialités importantes de développement économique. Demain, les modes de production qui dégraderont la qualité de l'environnement, notamment l'eau et la biodiversité, donneront des produits peut-être invendables sur le marché, car ils seront également dégradés. Il faut s'y adapter. Le potentiel économique de l'agroalimentaire français se joue sur cette transition.
Pour y arriver, l'adéquation des moyens et de la règlementation est un axe essentiel à promouvoir. Jusqu'ici, non seulement nous avons eu des moyens qui n'étaient peut-être pas complètement à la hauteur de l'ambition mais, en plus, sur un plan réglementaire, nous avons trop souvent privilégié des interdictions nationales, pas toujours adaptées dans tous les territoires. Il faut probablement redonner du poids et du pouvoir à des préfets de bassin qui ont effectivement une connaissance et une capacité à adapter la réglementation des molécules susceptibles de poser problème, territoire par territoire.
Je présente rapidement le bassin Loire-Bretagne, en rappelant que votre circonscription, Madame la présidente, est à cheval entre les deux bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne, puisque La Rochelle se trouve bien dans le bassin Loire-Bretagne. Ce bassin représente 28 % du territoire national ; il comprend l'ensemble du bassin de la Loire et de ses affluents, la façade maritime atlantique, la Manche atlantique, du Mont-Saint-Michel jusqu'à Châtelaillon-Plage.
Ce territoire compte 13 millions d'habitants. En tout, 67 % du bassin sont occupés par l'agriculture, ce qui correspond d'ailleurs au chiffre moyen national. Évidemment, les acteurs agricoles sont des acteurs essentiels de l'eau, à la fois sur les questions quantitatives et qualitatives. 36 % du produit national agricole est produit dans notre bassin, dont les deux tiers en production animale. Le bassin Loire-Bretagne pèse à peu près 60 % de la production animale française, ce qui explique d'ailleurs son poids plus faible dans l'utilisation de pesticides, aux alentours de 20 %.
L'agriculture pratiquée dans notre bassin évolue, à l'image de l'agriculture nationale : réduction du nombre d'exploitations, réduction des surfaces agricoles du fait de l'artificialisation. On perd à peu près 3 000 hectares de surface agricole utile chaque année. On observe aussi une forte réduction des prairies au fil des années, avec une céréalisation, le changement climatique favorisant d'ailleurs le développement de ces cultures en lieu et place des prairies. Les crises successives rencontrées par l'élevage le font également régresser. Nous assistons donc à un agrandissement des exploitations et à une simplification des systèmes de production. D'ailleurs, il suffit de traverser la France aujourd'hui pour s'en apercevoir. À certaines périodes de l'année, on est face à des monocultures sur des petits bassins versants.
Comme je viens de le dire, nous constatons la réduction des prairies. Or, les prairies sont, je le dis souvent, les amis de l'eau. Nous sommes confrontés à des pressions liées aux pesticides qui sont de plus en plus fortes, y compris dans des régions qui étaient peu concernées jusqu'à aujourd'hui, à l'instar du Massif central.
Chez nous, les bassins les plus touchés sont les grands bassins céréaliers : Centre Loire, l'ancienne région Poitou-Charentes, ainsi que les zones viticoles sur l'ensemble du bassin de la Loire. 27 % de nos masses d'eau, cours d'eau et nappes phréatiques sont déclassés du fait de la pression des pesticides. La dégradation de la qualité de l'eau est donc un sujet majeur sur notre bassin, à côté de questions de continuité écologique et de morphologie des cours d'eau.
Les effets du changement climatique accroissent la pression. Les phénomènes de précipitations très fortes ou de sécheresses répétées modifient toutes nos références de planification, de même que celles des agriculteurs. Il y a un enjeu essentiel de recherche appliquée pour l'agriculture pour permettre aux exploitants d'adapter leurs pratiques à un climat que l'on n'avait pas connu par le passé, hormis certains épisodes exceptionnels.
Je voudrais prolonger ce qu'a dit Guillaume Choisy sur le volet règlementaire. Je pense que nous n'utilisons pas assez les obligations des zones soumises à contrainte environnementale (ZSCE). Ces outils sont beaucoup utilisés en Bretagne pour des questions liées aux nitrates. Aujourd'hui, l'ensemble des baies bretonnes couvertes d'algues vertes font l'objet d'un dispositif dit de ZSCE. Je pense qu'il faudrait aller vers ce genre d'outils dans les aires d'alimentation, de captage prioritaire ou à enjeux. C'est sans doute l'un des enjeux pour les années à venir et on y travaille dans les comités de pilotage régionaux en Nouvelle-Aquitaine, avec le conseil régional. Des choses évoluent lentement et difficilement en la matière. Nous le voyons aussi dans la région Pays de la Loire où, dans chaque département, les préfets s'apprêtent à mettre en place ces dispositifs pour certains bassins versants.
J'ai le souvenir d'avoir croisé Dominique Potier aux états généraux de l'alimentation. C'est vrai qu'on attendait beaucoup de l'agroécologie, du dispositif « haute valeur environnementale » (HVE) à côté de l'agriculture biologique, que les agences accompagnent massivement. Nous espérions que l'agroécologie pourrait être un levier d'accompagnement de cette transition écologique des agriculteurs vers moins de pesticides. C'est plutôt une déception aujourd'hui.
Le bassin Seine-Normandie est le bassin de la Seine, de ses affluents et des fleuves côtiers normands. C'est un bassin fortement urbanisé, qui rassemble 30 % de la population française, dont une large partie est concentrée sur l'agglomération parisienne. Le territoire est fortement industrialisé mais c'est aussi – on le sait un peu moins – un bassin très agricole : 60 % de sa surface est agricole. L'agriculture est ainsi la première activité en termes d'occupation des sols ; nous y trouvons majoritairement de grandes cultures, en particulier de céréales. Il existe aussi une activité d'élevage dans les têtes de bassin à l'amont et en Normandie, mais cette activité est plutôt en perte de vitesse, la surface en herbe du bassin étant en recul. Tout cela génère évidemment différents types de pression sur la ressource en eau et sur nos milieux aquatiques, pression à la fois quantitative et qualitative.
Je reviens peut-être sur les grandes missions des agences, puisque mes collègues n'en ont pas forcément parlé de façon exhaustive. Nous exerçons un certain nombre de grandes missions en lien avec les comités de bassin, à commencer par la surveillance et la connaissance des milieux aquatiques. C'est un élément important pour étayer nos politiques publiques. Je cite également la planification – avec l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour nos bassins –, la gestion des redevances, qui sont nos recettes essentielles, et la mise en œuvre de dispositifs d'intervention financière et d'accompagnement technique et financier des maîtres d'ouvrage du bassin, en particulier des collectivités, mais pas seulement. Tous ces champs d'activité de l'agence de l'eau sont mobilisés dans le cadre de la lutte contre la pollution des eaux, qui est l'une de nos priorités historiques, parmi d'autres aujourd'hui.
Nous avons accompli des progrès très importants dans l'amélioration de la qualité des eaux par le passé, surtout grâce à la forte diminution des pollutions ponctuelles qui proviennent des industries, des stations d'épuration et du secteur domestique. Il est beaucoup plus difficile de réduire de la même façon les pollutions diffuses qui sont essentiellement d'origine agricole. C'est pour nous, comme pour les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne, une problématique majeure.
Pour vous donner quelques chiffres concernant la situation du bassin au regard des problématiques qui nous intéressent aujourd'hui, le résultat de la surveillance que l'on effectue sur nos cours d'eau et nos nappes souterraines montre que 26 % de nos cours d'eau sont déclassés, c'est-à-dire considérés comme en mauvais état au sens de la réglementation européenne, du fait de la présence de pesticides. C'est également le cas pour 61 % de nos nappes souterraines, sachant que la moitié de l'eau potable sur le bassin provient de ces nappes. Un enjeu particulier se dessine ainsi au sujet des nappes souterraines. Ces résultats n'ont pas beaucoup évolué. Depuis 2019, il n'y a pas eu de progrès mesurable, pas d'aggravation non plus.
Ce n'est pas neutre parce que si nous ne faisons rien collectivement, la situation pourrait se dégrader davantage. À l'évidence, un problème persistant de qualité de l'eau de nos cours d'eau et de nos nappes se pose, en raison de ces pollutions diffuses. Les principaux polluants détectés sont des pesticides – les herbicides en particulier – et des nitrates. Cela soulève de nombreux enjeux que vous connaissez : enjeux sanitaires pour les utilisateurs agricoles et la population ; enjeux environnementaux au regard de l'impact sur la biodiversité ; et enjeux économiques. Pour ne citer que le secteur de l'alimentation en eau potable, il y a un enjeu fort autour des mesures curatives qui doivent être prises par les collectivités afin d'assurer l'alimentation en eau potable. Cela suppose des traitements poussés et l'ouverture de nouveaux captages, de nombreux captages devant être abandonnés en raison d'un niveau de pollution trop élevé.
Face à cette situation, les agences de l'eau utilisent tous les leviers dont elles disposent afin de protéger la ressource en eau en amont. Je pourrai, au cours de l'audition, faire un bilan plus précis, à la fois quantitatif et qualitatif, des outils déployés par l'agence. Pour vous en faire un petit résumé, on a beaucoup d'aides en direction du secteur agricole et des collectivités pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau et de réduire la pression en produits phytosanitaires.
Vous évoquiez le programme Écophyto. La majeure partie de nos aides se fait en dehors de ce programme. Sur le bassin Seine-Normandie, nous consacrons environ 70 millions d'euros par an dans le cadre de notre onzième programme d'intervention (2019-2024) au secteur agricole, à des mesures qui contribuent à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est l'ordre de grandeur que l'on peut retenir. Il s'agit pour nous d'une forte montée en puissance, puisque nous étions plutôt aux environs de 30 millions par an lors de notre programme précédent. Nous avons poussé certaines mesures, comme le soutien à l'agriculture biologique, car on sait que les résultats sont là, en termes d'efficacité environnementale. C'est aussi le développement aval des filières à bas niveau d'intrants pour s'assurer que les cultures puissent trouver des débouchés par la suite. Nous utilisons un nouvel outil, celui du paiement pour service environnemental, qui s'est fortement développé, y compris sur ces problématiques de réduction d'utilisation des produits phytosanitaires.
En termes de perspectives, je pense qu'on a des marges d'amélioration de nos dispositifs d'intervention. Il nous faut être capables de dégager des priorités de financement puisque notre capacité financière n'est pas infinie. La priorité s'entend dans les deux sens. Il s'agit d'abord de bien se concentrer sur les territoires qui présentent des enjeux particuliers. Parmi ces territoires, nous trouvons les aires d'alimentation de captages. C'est aussi une priorité en termes d'ambition des mesures que l'on finance pour obtenir un résultat environnemental avéré. Enfin, nous devons mieux articuler collectivement les différents outils dont nous disposons. C'est une combinaison d'outils qui permettra de venir à bout de ce problème. L'outil d'intervention financière des agences doit être complémentaire des outils réglementaires ou fiscaux, par exemple. Tout cela doit se faire dans le cadre d'une gouvernance adaptée, avec la nécessité de bien partager les enjeux au niveau territorial sur ces problématiques.
Notre agence couvre deux bassins, le bassin corse et le bassin Rhône-Méditerranée. Le bassin corse est relativement peu important en termes de pollution agricole, le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Notre territoire est très diversifié : il comprend à la fois de grandes agglomérations, des secteurs ruraux, une industrie fortement présente sur certains secteurs et une agriculture très diversifiée, puisque nous avons à la fois une forte agriculture de montagne dans les secteurs jurassien et alpin, et des types d'agriculture plus intensifs, avec une forte activité viticole et arboricole. L'agriculture du bassin est globalement fortement utilisatrice de produits phytosanitaires.
Les résidus de phytosanitaires retrouvés dans les milieux aquatiques sont majoritairement d'origine agricole. La pollution par des résidus ou des produits pesticides est généralisée dans les cours d'eau et les eaux souterraines du bassin. Pour vous donner une idée, seuls 14,5 % des points de mesure sont exempts de tout produit phytosanitaire, dans les zones montagneuses. Cela veut dire que l'on a une imprégnation générale de l'ensemble des milieux aquatiques, qu'il s'agisse des eaux souterraines ou des eaux superficielles. Cela ne signifie pas que la pollution est grave partout. La situation apparaît un peu moins mauvaise s'agissant des eaux souterraines.
Au-delà des pollutions par les milieux aquatiques, superficiels ou souterrains, les pesticides peuvent aussi se retrouver en Méditerranée. En toile de fond de nos actions, il convient ainsi de mentionner la protection de la Méditerranée.
La politique d'intervention de l'agence s'est fondée sur le constat que nous n'avions pas des moyens financiers à la hauteur, par exemple, de la politique agricole commune, et que nous devions donc cibler nos interventions financières. Notre conseil d'administration et les comités de bassin ont ainsi choisi de cibler les territoires à fort enjeu. Il s'agit notamment des captages prioritaires utilisés pour l'eau potable, qui présentent des niveaux de pollution importants. C'est aussi la préservation des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable – il s'agit ici des ressources qui, dans le futur, seront susceptibles d'être utilisées pour l'eau potable et qu'il convient de protéger. Nous surveillons plus largement les zones à enjeux phytosanitaires, c'est-à-dire là où existe une pression phytosanitaire forte. Je précise que nos actions sont décroissantes en termes de financements et de dispositifs mobilisables selon qu'on parle des captages prioritaires ou des secteurs plus larges que j'évoquais.
Nous sommes la deuxième agence en termes de poids financier, derrière l'agence Seine-Normandie. Nous consacrons environ 40 millions d'euros chaque année à la lutte contre les pollutions agricoles. C'est un montant significatif, presque un dixième des dépenses de l'agence, et ce sont principalement des aides situées en dehors des dispositifs du plan Écophyto. Nous finançons notamment des aides à la conversion à l'agriculture biologique, le soutien aux filières bas niveau d'intrants – avec des expérimentations, des appels à projets pour essayer de soutenir ces filières – et les paiements pour services environnementaux qui ont été mis en place à titre expérimental.
La pollution par les pesticides pose deux difficultés. La première, c'est son caractère diffus. On a beaucoup agi sur les pollutions ponctuelles, avec de belles réussites. Il est plus difficile d'intervenir sur les pollutions diffuses en raison du nombre des interlocuteurs à mobiliser. La deuxième difficulté, c'est que nous sommes dans un domaine compliqué, s'agissant des connaissances et de la compréhension qu'on peut avoir des enjeux.
Ainsi, même si nos réseaux de mesure sont assez denses pour rechercher les pesticides, ils restent relativement lâches. Par ailleurs, les pesticides sont très rémanents : vingt ans après l'interdiction de l'atrazine, on la retrouve dans les captages. C'est un problème pour notre capacité à mobiliser les agriculteurs, puisqu'on trouve des substances qu'ils n'utilisent plus. Enfin, nous accusons toujours un retard dans l'identification des produits ou des métabolites qui peuvent poser problème ; nous avons toujours un peu l'impression de courir derrière quelque chose. Il y a également la question des métabolites ; on ne sait pas toujours s'il faut, ou non, les prendre en compte pour évaluer la potabilité de l'eau, les appréciations peuvent ainsi varier.
Ainsi, toutes ces difficultés liées à la complexité du sujet rendent difficile la mobilisation des acteurs.

Nous voyons que vous avez effectivement des assolements totalement différents, et c'est toute la richesse de vos interventions, mais vous partagez tous une préoccupation sur la qualité de l'eau. Vous pourrez peut-être évoquer aussi la question des quantités ?

Vous comptez parmi les acteurs publics les plus engagés sur la question des pesticides. Cette audition sera essentiellement consacrée à l'action publique que vous incarnez dans ce domaine. Nous avons déjà eu l'occasion de traiter la question de la qualité de l'eau lors de la première phase de nos auditions.
Aujourd'hui, on est à un peu près stable dans l'utilisation des produits phytosanitaires, du moins si l'on considère le Nodu, qui était l'indicateur sacré il y a dix ans – il est aujourd'hui relativisé, vous avez peut-être une opinion à ce sujet ?
Ma première question consiste à savoir si vous voyez émerger des enjeux nouveaux autour de l'articulation entre quantité et qualité de l'eau. Le stress hydrique nous prive d'une des solutions à disposition pour rendre l'eau potable, qu'est la dilution. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une question majeure à terme ?
La question des pesticides n'est-elle finalement pas directement liée à la question de l'accès à l'eau potable ? Il existe un débat idéologique, selon lequel il faudrait choisir entre se nourrir et être en bonne santé. Mais la première ressource, c'est l'eau. L'accès à l'eau potable n'est-il pas conditionné à une politique de réduction des pesticides ?
La question des moyens est aussi importante. Nous voyons que la part de la redevance pour pollution diffuse (RPD) est en réalité très relative, de l'ordre de 10 % de l'ensemble des moyens déployés. Les agences utilisent des ressources propres pour lutter pour les produits phytosanitaires. Tout cela est assez illisible sur le plan des politiques publiques, nous avons du mal à reconstituer l'ensemble des montants financiers et à déterminer qui finance quoi.
Cette complexité des canaux de financement, qui transitent partiellement par l'Office français de la biodiversité, se double d'une architecture interministérielle peu lisible. Ce fonctionnement interministériel vous semble-t-il opérationnel aujourd'hui ? Parvenez-vous à vous en affranchir, parce que vous travaillez sur un territoire avec un objectif – peu importe d'où vient l'argent ? Ou, au contraire, cette complexité dans les financements et dans la gouvernance est-elle pour vous un problème, qui pourrait susciter des recommandations de la part de notre commission d'enquête ?
Enfin, votre cœur de métier, c'est l'eau. En cela, êtes-vous vraiment les acteurs ad hoc pour agir en matière d'agroécologie ? Comment voyez-vous votre rôle et votre action, à l'échelle locale et à l'échelle globale ?
Je réponds à la première question, relative au stress hydrique. Un excellent article a été publié il y a quelques jours dans Le Monde sur le sujet. Dans un bassin comme le nôtre, où 60 % de la population et tout le bassin de la Garonne – Toulouse compris – sont alimentés par des rivières sans aucune substitution possible, des difficultés se font jour lorsque la température de l'eau approche les 35 degrés.
Ces difficultés sont de deux ordres.
Quand je suis arrivé à ce poste il y a six ans, on disait que les problèmes de bactéries étaient derrière nous. Nous voyons qu'avec le changement climatique, nous les retrouvons de façon très importante. Cet été, nous avons battu des records de difficultés de gestion de la bactérie sur notre bassin, sur des départements comme le Tarn-et-Garonne et l'Aveyron, même au-delà, et de façon massive. Quand l'eau dépasse les 25 degrés, nous avons des problèmes avec la chloration de l'eau, le chlore perdant son efficacité ; nous avons ainsi du mal à maintenir la qualité de l'eau, même en rajoutant des points de chloration. En outre, plus on injecte de chlore, plus on a de chlorites ; or, la directive européenne sur l'eau souligne que ces substances sont à surveiller sur le plan sanitaire.
La deuxième problématique est liée à l'effet de concentration. Dans le Gers, nous avons été obligés de mettre en place des systèmes de microfiltration et de filtres à charbon. Les filtres à charbon durent en principe entre deux à cinq ans dans les stations des villes moyennes. Dans le Gers, 38 % des surfaces agricoles sont en bio, mais nous n'avons pas réussi à diminuer pour autant la masse des pesticides en raison de la rémanence des herbicides. Nous avons donc encore besoin de traiter de façon massive : un filtre à charbon dure six mois au grand maximum ; passé ce délai, il n'est plus efficace parce qu'il est saturé. Cette situation entraîne des coûts de fonctionnement importants. Si nous savons nous adapter pour les investissements, c'est moins vrai pour les coûts de fonctionnement, qui explosent.
Pour répondre à votre question sur le Nodu, nous comptons un million de molécules aujourd'hui dans la Garonne. Je vous remettrai un rapport tout à l'heure. Nous avons organisé un séminaire en juillet dernier à Bordeaux, avec des scientifiques qui nous ont expliqué qu'un million de molécules habitaient nos rivières. Nous en suivons à peu près 300, ce qui nous coûte 20 millions d'euros chaque année. Les plus importantes et les plus massives sont d'origine agricole. Nous constatons une baisse des molécules dites « CMR 1 » – les plus cancérigènes – de 40 % sur le bassin et aussi une baisse du nombre de molécules utilisées en agriculture de l'ordre de 7 %. Mais il va falloir que l'on s'intéresse assez rapidement à l'impact des molécules du biocontrôle sur le milieu.
La question suivante portait sur les moyens. Monsieur le député, dans votre rapport, vous indiquez qu'il faudrait arriver, pour être efficace, à 1,5 % du produit intérieur brut agricole. Nous n'y sommes pas encore… Il est ainsi probablement nécessaire de mobiliser des moyens supplémentaires en faveur de la réduction de l'usage des produits phytosanitaires.
Comment développe-t-on l'agroécologie ? Quand on arrive à une diminution significative, sur l'ensemble des exploitations, de l'ordre de 20 à 25 % des produits phytosanitaires utilisés, quand on arrive à peu près à 30 ou 35 % d'agriculture bio sur un territoire, on constate des résultats, mais seulement après quinze ans, en raison de la rémanence. Aujourd'hui, l'une des molécules que l'on retrouve le plus, c'est l'atrazine. Je suis sûr qu'il n'y a pas un agriculteur qui l'utilise depuis 2003, mais elle est encore présente, y compris dans les autres surfaces, et elle descend. On la retrouve par exemple en Charente-Maritime, à 300 mètres de profondeur. Tout cela est lié à la rémanence dans les sols.
Dans un bassin comme le nôtre, environ 20 % des moyens sont consacrés à l'agriculture, financés à moitié par la RPD et à moitié par les redevances sur le secteur domestique. Il y a donc un effort collectif en faveur de l'agriculture. Ce sont souvent des mesures de prévention, parfois aussi des mesures curatives. 40 % de ces moyens sont consacrés à des mesures agro-environnementales ou de reconversion à l'agriculture biologique. Par ailleurs, 25 % de ces montants sont investis dans l'adaptation des filières pour diversifier et réduire, par exemple, les monocultures de maïs. Un minimum d'irrigation est parfois nécessaire pour sécuriser cette agroécologie. C'est vrai pour le soja, les productions de protéines, les filières de chanvre. On a besoin de l'eau, souvent de volumes moins importants, mais plus longtemps dans la saison. Au mois d'août, dans un bassin comme le nôtre, les rivières ne sont pas capables de supporter beaucoup d'irrigation, elles sont en seuil très bas. Cela suppose donc des mesures de sécurisation, comme la substitution ou le stockage.
Je vais insister sur l'impact du changement climatique sur les pratiques agricoles et le bouleversement des références. Les données des dix dernières années sont complètement différentes de tout ce que nous avons pu connaître par le passé. Or, nos systèmes – nos systèmes de production agricoles en particulier – se sont construits dans le temps et sur la base de références historiques. Qui mieux qu'un agriculteur peut nous rappeler les conditions climatiques des années passées ?
Lors du Varenne agricole, le groupe 2, piloté par la présidente des instituts techniques, a travaillé sur l'adaptation. À mon avis, nous n'avons pas assez mis en avant ses résultats. Nous devons améliorer le conseil agricole pour aider les agriculteurs à faire face à des évènements complètement différents. Je ne suis pas sûr que la dilution soit un moyen de traitement pour les pesticides. Mais il faut en effet, je pense, renoncer à l'idée que dans une masse d'eau importante, un fleuve ou une grande nappe phréatique, l'impact de l'activité humaine sera réduit. Nous le voyons avec la Loire, qui perd une part importante de ses débits de façon maintenant régulière, ce qui nous amène à nous réinterroger sur les rejets, y compris des collectivités locales.
Nous ne pouvons pas opposer l'accès à l'eau potable et la sécurité alimentaire. Nous sommes de plus en plus confrontés, dans tous les débats sur la gestion de l'eau, à cet argument de la sécurité alimentaire. Je n'ai pas encore exactement compris d'ailleurs ce qu'on mettait véritablement derrière la sécurité alimentaire, et je pense qu'il faudrait la redéfinir précisément. Le débat devient de plus en plus difficile, alors même qu'on doit assurer à la fois la première sécurité alimentaire, celle de l'eau, et la sécurité alimentaire de l'Union européenne, sans doute, et de la France. Il faut concilier les activités économiques avec cette reconquête de la qualité de l'eau que l'on poursuit déjà depuis de nombreuses décennies, d'autant que l'on va avoir besoin à nouveau de ces captages que l'on a quelquefois abandonnés par le passé parce qu'ils dépassaient les normes. Il y a un enjeu à reconquérir ces ressources pour retrouver l'équilibre dans l'accès à l'eau potable sur certains territoires.
S'agissant de la question des ressources et des financements, je rappelle toujours que les agences de l'eau sont des outils de mutualisation, un peu comme le budget de l'État. Il ne devrait pas y avoir d'affectation particulière d'une ressource à une dépense. L'ensemble des redevables doit contribuer à reconquérir la qualité de l'eau. C'est d'ailleurs ce que les agences de l'eau ont fait massivement par le passé quand elles ont accompagné la mise aux normes des bâtiments d'élevage dans le cadre des différents programmes de maîtrise des pollutions d'origine agricole. Les consommateurs d'eau ont participé de façon très importante à la mise aux normes de ces bâtiments. De la même façon, je pense qu'il faudrait abandonner l'idée d'une affectation des ressources au sein des agences de l'eau. Il y a des recettes d'un côté, qui rentrent dans le budget des agences de l'eau, lesquelles les affectent, dans le cadre de leur gouvernance autour des conseils d'administration et des comités de bassins, en fonction des priorités. Ce qui fait, d'ailleurs, que les agences de l'eau affectent plus d'argent aux actions agricoles qu'elles n'ont de recettes venant de l'agriculture.
Je passe ce message parce que je pense que ce serait peut-être plus lisible, sachant que nous pouvons déployer toute la traçabilité nécessaire dans nos outils de gestion financière, pour indiquer d'où viennent nos ressources et comment est affecté notre budget.
Sommes-nous « mono-sujet » sur l'eau ? C'est le combat des agences de l'eau depuis la loi de 1964, dont on va bientôt fêter les 60 ans. C'est évidemment la ligne conductrice de notre action. Il y a eu des périodes où l'on ne parlait plus beaucoup d'eau. Comme elle est l'un des principaux marqueurs du changement climatique, elle redevient aujourd'hui un sujet essentiel pour tous.
Comment agir sur les questions agricoles ? Sandrine Rocard rappelait les 9 milliards d'euros de la politique agricole commune, à comparer aux 300 millions d'euros que les agences de l'eau apportent, grosso modo, chaque année à l'agriculture. Il faut rester modeste dans notre capacité à agir sur la politique agricole. En revanche, il nous semble essentiel que la démocratie locale de l'eau soit la base de la politique de l'eau dans les territoires des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage), avec les commissions locales de l'eau qui représentent l'ensemble des usagers. C'est là que l'on doit aussi agir, la question des pesticides doit se traiter au sein de ces commissions locales. Les projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) que l'on met en place avec un objectif largement quantitatif doivent comporter un volet qualitatif. Ces projets de territoire doivent traiter de l'ensemble de la question de l'eau, avec tous les usagers et avec le monde agricole.

Vous dites que la question des pesticides n'est pas spontanément prise en compte dans les Sage.
Elle est traitée dans la planification des Sage, dans l'état des lieux mais, s'agissant des projets de territoire pour la gestion de l'eau, c'est vraiment le moment, me semble-t-il, de traiter à la fois la quantité et la qualité et d'agir, à ce niveau, au sein du bassin versant et du territoire.

Au-delà des sujets philosophiques, nous sommes à la recherche de mesures et de propositions opérationnelles. Celle-ci me paraît intéressante. Nous ne sommes pas que sur la gestion et le partage des quantités, la sobriété, etc. Nous pouvons être également sur la qualité et la quantité. Je précise qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la dilution. Je ne dis pas que c'est un idéal, mais une marge d'action dont nous serons privés de fait.
Sur le bassin Adour-Garonne, la moitié du débit est assurée par une dilution par les lacs hydroélectriques. Sans cela, nous ne serions pas capables de maintenir la qualité, c'est donc quand même un garde-fou. En revanche, la dilution n'a aucun effet sur la température de l'eau : il n'est pas possible de maintenir la température de l'eau de cette manière.

Vous nous avez sensibilisés sur cet enjeu des températures de l'eau, avec les bactéries qui se développent. Mais il n'y a pas d'interaction entre les pesticides et les températures ?
Non, c'est en effet un problème de bactériologie.
En Adour-Garonne, nous avons créé il y a quatre ans ce qu'on appelle « l'entente pour l'eau » qui réunit les deux régions, l'agence de l'eau, le préfet de bassin et l'État pour financer toutes les politiques publiques sur la qualité et la quantité d'eau. S'agissant des pesticides, tout est ainsi cofinancé et organisé dans une même stratégie commune.
Par ailleurs, en juillet, nous avons auditionné les deux agences régionales de santé, car nous avons un problème d'adéquation entre les molécules surveillées dans l'eau et les molécules utilisées en agriculture. Nous avons mis en place un comité pour rétablir cette adéquation.

Parmi les outils qui nous manquent aujourd'hui, je cite la traçabilité de l'usage des molécules. Il n'y a pas de traçabilité dans notre pays. C'est un manque criant. Cet outil pourrait-il être utile ? Réduire les usages, c'est les connaître dans la pratique. Or, nous n'avons pas de données à ce sujet.
Je souhaiterais revenir sur la première question que vous évoquiez, celle de l'impact du stress hydrique sur l'accès à l'alimentation en eau potable. Les aspects de qualité et de quantité sont intimement liés et on ne peut pas se permettre de traiter ces sujets en tuyaux d'orgue. D'après les scénarios futurs, nous aurons une baisse tendancielle du débit des cours d'eau de 10 à 30 %. Ce sont les projections pour le bassin à l'horizon 2070-2100. Cette situation réduira la capacité de dilution des polluants dans les cours d'eau. Ce seront autant d'eaux brutes qui seront potentiellement plus polluées, y compris par les produits phytosanitaires. C'est très clair.
Par ailleurs, nous avons ce problème d'abandon régulier de captages d'eau potable. Je peux vous donner quelques chiffres pour le bassin Seine-Normandie. Nous avons plus de 6 800 points de prélèvement destinés à l'alimentation en eau potable. En 2022, plus de 1 700 de ces points de prélèvement avaient dû être abandonnés. Environ 40 % des abandons sont liés à des pollutions diffuses d'origine agricole. Tous ces abandons de captage nous privent de ressources en eau pour l'alimentation en eau potable, alors que l'eau sera de moins en moins disponible, notamment en période estivale, pour les différents usages. L'usage d'alimentation en eau potable est effectivement prioritaire.
Vous posiez la question de la lisibilité, de la multiplicité des acteurs et finalement de la place des agences de l'eau. Portent-elles uniquement le sujet « eau » ? Nous avons fait la démonstration que nous sommes capables d'intégrer les différentes politiques sectorielles dans nos enjeux. C'est même tout l'objet de nos politiques : intégrer les politiques sectorielles en matière d'agriculture, d'urbanisme, de transports, etc. C'est quelque chose que l'on peut faire dans nos instances de bassin. Nous animons une gouvernance très importante au niveau du bassin et au niveau territorial, où nous retrouvons l'ensemble des acteurs concernés, la fameuse multiplicité d'acteurs dont vous parliez, à commencer par les collectivités, les services de l'État qui portent les enjeux sanitaires, agricoles ou environnementaux, la profession agricole à travers une représentation par les chambres de l'agriculture et la Fédération nationale de l'agriculture biologique.
Dans nos comités de bassin, nous regroupons l'ensemble des acteurs qui portent les différentes politiques et nous essayons d'animer cette gouvernance pour qu'elle aboutisse aux résultats que nous souhaitons. Au niveau territorial, cette même gouvernance doit être mise en place, et les agences de l'eau y travaillent aussi, autour de projets de territoires qui soient cohérents sur des bassins versants donnés, sur des zones à enjeux donnés, pour arriver à dégager les politiques les plus efficaces.
Il y a des interactions avec le niveau national aussi. Vous vouliez savoir s'il fallait agir globalement ou localement. Il existe de fortes interactions entre le niveau de bassin territorial et le niveau national qui doit nous donner la cohérence, nous aider à construire le cadre et les outils réglementaires à la main des préfets, pour bien articuler ce que chacun fait. Les bassins ont été amenés à faire remonter des propositions, notamment dans le cadre du plan Eau récemment, mais aussi sur d'autres sujets, y compris au niveau national.
Votre dernier point portait sur la traçabilité de l'usage des molécules. Effectivement, nous sommes assez démunis, au sein des agences de l'eau. Notre meilleur moyen d'approcher cette traçabilité est le Nodu. C'est l'indicateur de pression utilisé dans le cadre du plan Écophyto ; nous pouvons le suivre au niveau des bassins et ainsi, avoir une idée des usages agricoles. C'est une approche indirecte, fondée sur la quantité de substances actives vendues, mais modulée quand même par l'efficacité du produit et l'usage du produit qui est recommandé. Je reconnais que c'est très imparfait.
Il est difficile de traiter séparément les enjeux de qualité et de quantité de l'eau. Cependant, il faut se garder de trop généraliser en considérant que l'eau s'est évaporée, ce qui fait que les pesticides sont plus concentrés. Ce n'est pas toujours si simple, notamment si on considère les eaux souterraines. Je vois deux sujets à prendre en compte, concernant ce lien entre qualité et quantité.
Premièrement, l'outil des fermetures de captages pour des problèmes de qualité est aujourd'hui fragile en raison de cette question des quantités. J'ai en tête quelques communes en rupture d'alimentation potable en 2022, parce qu'on avait dû abandonner quelques années auparavant des captages qui n'étaient pas disponibles. La facilité que nous pouvions avoir il y a cinq ou dix ans à fermer les captages pollués ne sera plus la règle à l'avenir, parce qu'on se heurte aux limites de notre capacité à fournir l'eau en quantité suffisante.
Ensuite, il faut mentionner l'effet des modes de précipitation, de plus en plus violents, avec beaucoup de ruissellement. Ce ruissellement induit des relargages beaucoup plus importants de produits phytosanitaires. On peut donc avoir des « flashs » de phytosanitaires emmenés par des précipitations alors qu'auparavant, ils tombaient beaucoup plus lentement, percolaient et ruisselaient beaucoup moins. Ces phénomènes peuvent extraire des polluants de sols agricoles qui n'ont pas été traités depuis longtemps.
Oui, s'il pleut très fort et si les sols sont secs, l'eau ne s'infiltre pas, l'eau ruisselle et se retrouve dans les cours d'eau.
J'ai dit tout à l'heure que notre agence finançait environ 40 millions d'euros par an d'interventions en faveur de la transition agricole, de la réduction des pesticides. Le produit de la redevance pour pollution diffuse versé à l'agence se situe autour de 20 millions d'euros. C'est la moitié. L'agriculture est ainsi le seul usager du bassin qui bénéficie de beaucoup plus d'aides qu'il ne paye de redevances. C'est la solidarité de bassin, mais elle a aussi ses limites. Les autres catégories – industriels ou les collectivités – nous font passer le message que la solidarité a des limites. Comme les besoins sont plutôt croissants dans le domaine agricole, compte tenu de la transition, à la fois sur la qualité, mais aussi sur la quantité, la question se pose d'augmenter aussi la pression fiscale sur l'activité agricole pour justifier l'effet de levier que je viens d'évoquer, et qui sera toujours présent. Si nous restons sur 20 millions de recettes agricoles, nous ne passerons peut-être pas à 60 ou 70 millions d'euros de dépenses, alors que si nous augmentons un peu, nous pourrons faire valoir ce levier auprès de nos instances.

Je suis un fervent défenseur des projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE), assis sur des études hydrologie, milieux, usages et climat (HMUC) solides. L'article 6 du projet de loi d'orientation agricole qui nous a été soumis et qui vise à remettre tout cela en cause me semble être une catastrophe, y compris dans la gestion locale de ces PTGE.
On a parlé tout à l'heure des moyens. Au-delà de l'effet de levier, qu'est-ce qui est susceptible de faire basculer la décision des agriculteurs, de les convaincre de réduire ou d'abandonner l'usage de pesticides ? Monsieur Choisy, vous disiez qu'abandonner 25 ou 30 % de l'usage, c'est déjà un gros progrès. Avec des redevances dégressives, avec des redevances pour pollution diffuse qui sont moitié moins que ce que vous mettez pour réparer ces pollutions, n'avons-nous pas un levier de contraintes fiscales qui permettrait d'enclencher des décisions d'abandon des pesticides ? Il s'agit ici d'une pression négative sur les agriculteurs.
Par ailleurs, ce que disait Madame Rocard sur les paiements pour services environnementaux m'intéresse particulièrement puisque j'avais moi-même proposé que l'on ait une pression positive, c'est-à-dire un accompagnement des agriculteurs il y a quatre ans, en demandant la création d'un fonds pour paiements de services environnementaux. La pression négative contraignante s'accentue, on leur demande plus de contributions, ce qui est normal parce que ce sont eux qui émettent mais, en même temps, on a ce fonds doté et suffisamment puissant pour être un levier positif pour les aider à faire cette bascule.
Les agriculteurs arbitrent, comme nous tous. Ils ont des contraintes économiques. Si on ne joue pas sur les leviers qui permettraient de faire bouger un peu le curseur, il n'y a pas de raison qu'ils abandonnent les pesticides.
Que pensez-vous de l'idée de mieux mobiliser ces deux leviers, un levier contraignant et un levier d'accompagnement à la hauteur des enjeux que vous mesurez ?
Nous avons toujours les deux composantes de la redevance, l'effet incitatif direct et l'apport de moyens financiers supplémentaires. Je vais prendre une métaphore entre les pesticides et le basculement vers un véhicule électrique. Nous savons très bien qu'il va falloir arrêter les véhicules thermiques. Comment faisons-nous ? Nous pouvons optimiser en passant à l'hybride, mais sommes toujours dans un système thermique. De la même manière, on peut réduire de 30 % les pesticides sans changement de système, mais ce n'est pas le basculement attendu. Comment s'opère cette bascule ? Il peut y avoir un outil financier avec la redevance, de la même manière qu'on augmente le prix de l'essence. Les gens sont incités. C'est compliqué pour l'usager de la voiture comme pour l'agriculteur. C'est une forme de réglage entre l'incitation positive et l'incitation négative.
Le message que j'avais voulu faire passer, c'est que, certes, ce sont toujours des contraintes financières d'augmenter la redevance de pollution diffuse, mais c'est aussi le moyen d'enclencher une dynamique au niveau de nos bassins pour optimiser l'effet de levier et faire en sorte que les autres usagers soient d'accord pour remettre au pot. La seule certitude que nous avons, c'est qu'il faudra plus de moyens financiers. Quand les agents se sont engagés dans les paiements pour services environnementaux, ils devaient le faire à titre expérimental et il était question que cela soit repris par la politique agricole commune. Cela ne s'est pas passé ainsi. Les agences disent qu'il faut continuer et effectivement, il y a une demande sur le terrain, les agriculteurs qui en font usage en voient bien les effets. On faut agir localement avec ces outils-là, mais le coût est élevé.

On taxe et on aide. Cela s'appelle une taxe affectée. Philosophiquement, ce n'est pas bien, c'est l'argent de la nation, tous contribuent au bien commun, etc. Mais c'est une façon pédagogique de faire assimiler une réforme. J'avais écrit en 2014 que chaque euro prélevé devait revenir dans le champ. Il est drainé et il irrigue en même temps une politique nouvelle.
Je pense que dans le contrat social, dans la mutation que l'on a à vivre, c'est quelque chose qui peut fonctionner. En revanche, comment une agence de l'eau peut-elle le faire, sachant que cela va la conduire à financer des actions en rapport avec la biodiversité et la santé humaine, sans lien avec l'eau ? Est-elle autorisée à faire cela ? Cela devrait plutôt être une politique régionale. Je pense qu'on est forcés de s'intéresser à la question des tuyaux financiers et de la gouvernance. On ne va pas vous reprocher de vous occuper de l'eau, mais dès lors que vous auriez à gérer des paiements pour services environnementaux dans le cadre d'une politique plus globale, il y aurait une sorte de dissonance avec la mission qui est la vôtre.
Je pense que l'on n'aura pas de progrès si l'on ne s'intéresse pas au champ économique. Quand on fait des mesures agro-environnementales (MAE), on répare quelque chose, on met de la rustine. Quand on fait des paiements pour services environnementaux (PSE), on reconnaît aux agriculteurs des pratiques qui vont dans le sens de la préservation de l'environnement sur des critères de qualité ayant trait à l'indice de fréquence de traitement (IFT), à l'assolement, au développement de l'agroécologie. Nous avons travaillé avec les coopératives. Nous avons fait 900 PSE en Adour-Garonne. Ils ont cinq ans maintenant et nous sommes capables d'en mesurer la qualité. Ils visent des enjeux de transition vers l'agroécologie, de diversification des productions ; mais il faut du temps. Nous avons sans doute besoin de cet instrument incitatif qu'est la redevance pour pollution diffuse ; peut-être faudrait-il l'amplifier. Mais ce qui a souvent fait défaut, ce sont les outils. Nous savons qu'il va falloir trouver les moyens d'amplifier, de massifier ce que nous avons entrepris.
C'est la même chose pour les PTGE. En Adour-Garonne, on a adopté au mois d'avril une délibération considérant que tout PTGE était d'abord de la substitution, avec par ailleurs des exigences sur le développement de l'agroécologie. C'est nécessaire si l'on veut garder une productivité et protéger une filière. Il faudra de l'eau. Le problème n'est pas l'irrigation, même s'il faut la sécuriser, notamment sur les nappes. Nous avons fait des études sur le changement climatique bassin par bassin. Il faut un équilibre entre les prélèvements, prioritairement en rivière, parce que les nappes se remplissent difficilement, en tout cas pas tous les ans. Cet hiver, elles ne se sont pas remplies. Il faut trouver un système qui permette de garantir à la fois ce remplissage et la transition vers des modèles agricoles qui impactent moins. Cela prend du temps parce que ce sont de nouvelles filières, de nouveaux assolements. Parfois, on se réjouit parce qu'il y a moins d'irrigation, mais en réalité on fait du blé et de la monoculture de céréales, dont la consommation de pesticides est plus importante que celle du maïs et qui impacte plus nos sols.
Nous devons donc avoir une stratégie plus globale et une approche effectivement territoriale. Les actions territoriales ne seront pas les mêmes d'un territoire à l'autre, d'un bassin à l'autre. En revanche, il faut réfléchir avec les acteurs économiques. Ce sont les EPCI, les régions qui ont la responsabilité économique. On doit avoir une stratégie commune, y compris entre ministères de l'agriculture et de l'environnement. Si on éparpille les moyens, on aura du mal à travailler. Le Varenne de l'eau a été, à ce titre-là, un bon exemple de convergence des politiques publiques.

Quand on parle de la qualité de l'eau en France, le premier mot qui nous vient à l'esprit est celui de pesticide. Mais nous voudrions aussi avoir des précisions sur la question des micropolluants, des microplastiques.
Par ailleurs, dans ces milieux aquatiques, parvenez-vous à tracer l'origine de ces polluants ?
S'agissant des pesticides, parvenez-vous à avoir une idée de l'évolution au cours du temps de la présence et des concentrations dans les eaux ? Connaissez-vous ces évolutions par famille de pesticides ?
Avons-nous des éléments sur l'impact sur la qualité de l'eau des campagnes de désinsectisation conduites à proximité des plans d'eau, notamment dans les zones touristiques ?
Y a-t-il un impact identifié de l'augmentation de la température des eaux liée au changement climatique sur les pesticides, en termes de dégradation ou d'accélération ? Je parle des différents processus chimiques et physico-chimiques. On s'y intéresse par exemple pour le fonctionnement de nos centrales nucléaires, pour la biodiversité, etc. Qu'en est-il s'agissant des pesticides ?

Parmi les polluants qu'on trouve dans les eaux, mon collègue évoquait les microplastiques, mais il y a aussi la question des produits pharmaceutiques. Pourriez-vous nous donner un panorama global de la part des différentes familles de polluants ?
Nous avons des mesures vraiment très fouillées concernant de nombreux paramètres ; je pense que le plus simple serait de pouvoir vous fournir ces données précises. Nous arrivons à une connaissance fine des différents polluants.
Pour ce qui concerne les produits phytosanitaires, nous sommes plutôt certains qu'ils sont d'origine essentiellement agricole parce que les usages non agricoles – pour les collectivités et pour les particuliers – ont été interdits par la loi Labbé.
Nous ne disposons pas d'éléments probants sur l'impact de l'évolution de la température de l'eau sur les produits phytosanitaires.
Je voulais revenir sur les paiements pour services environnementaux. Je pense que les agences ont toute légitimité pour intervenir avec des dispositifs qui ont des bénéfices multiples. Sur l'eau évidemment, puisque c'est notre cœur de métier ; mais notre champ d'action va bien au-delà. La biodiversité et la préservation de la biodiversité sont des enjeux importants pour les agences de l'eau. Depuis la loi sur la biodiversité de 2016, nous avons beaucoup investi ces sujets. Nous investissons aussi les enjeux sanitaires, autour du concept « One Health ». Tous ces sujets sont en réalité liés. Nous croyons beaucoup aux paiements pour services environnementaux, d'abord parce que c'est, pour l'agriculteur qui en bénéficie, une logique assez différente des subventions qu'il peut toucher dans le cadre de la politique agricole commune. Ici, on reconnaît et on rémunère un service rendu. Ces dispositifs sont adaptés à la situation d'un territoire donné. La collectivité locale est impliquée ; c'est important aussi qu'il y ait un élu qui soit porteur de ces dispositifs, qui les anime, qui puisse diffuser cette problématique de l'eau. Et c'est un dispositif intéressant aussi parce que le paiement du service est en partie conditionné aux résultats obtenus. Il est ainsi vraiment tourné vers l'efficacité environnementale et peut rémunérer toutes sortes de services – dont la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires.
Bien évidemment, les agences de l'eau y sont très favorables. Le niveau d'ambition doit être établi au niveau local. En revanche, il est nécessaire de proposer un niveau de rémunération suffisant pour que les agriculteurs soient incités à y adhérer.
Si l'on constate une évolution favorable au niveau des ventes de produits – les ventes des produits les plus toxiques ayant tendance à baisser, notamment en raison de certaines interdictions – on a du mal à apprécier ces tendances s'agissant de l'évolution de la qualité des eaux. Le phénomène de rémanence, qui fait qu'on retrouve encore des molécules interdites dix ou vingt ans plus tard, explique en partie ces difficultés.
Les ventes des molécules dites « CMR 1 » qui sont classés cancérigènes ont, sur un bassin comme le nôtre, baissé d'à peu près 40 % sur les cinq dernières années. Elles représentent encore un tiers des molécules vendues et des produits vendus, malgré les interdictions et les efforts des filières, des distributeurs et des agriculteurs. Dans certaines filières, ces produits sont toujours très présents. Nous avons encore besoin de mutations, et pas seulement dans la culture de céréales. Je pense que le maraîchage et l'arboriculture utilisent encore un peu ces molécules en l'absence d'alternatives. Il faut renforcer la recherche dans ce domaine.
Je le disais, sur un million de molécules présentes dans les eaux, on en suit 300. C'est l'Ampa, un métabolite du glyphosate, que l'on retrouve le plus souvent. Il est probablement plus dangereux pour la santé que ne l'est le glyphosate parce qu'il se dissout très vite dans le sol et dans l'eau.
Au sujet des différentes familles de polluants présentes dans les eaux, je crois qu'il sera nécessaire, à l'avenir, d'avoir une politique qui soit plutôt tournée vers les impacts de ces molécules, parce que je ne suis pas sûr que l'on soit capable, notamment pour l'ensemble des micropolluants, d'identifier les sources de contamination. Aujourd'hui, l'agriculture est la source la plus importante en volume mais parfois, il doit exister des effets cocktails, dus notamment à la concentration ou peut-être à la température. Il faudrait approfondir le sujet sur le plan scientifique. Il faut donc regarder l'impact de l'ensemble de ces molécules sur le vivant et sur les milieux.
Lors du colloque organisé avec les scientifiques en juillet, que j'évoquais tout à l'heure, une accélération a été évoquée. Dans quelle mesure est-elle plurifactorielle ? On a de plus en plus de molécules diverses. Est-ce que cette accélération est liée au fait d'avoir de plus en plus de micropolluants ou est-ce le fait de les concentrer plus ? En tout cas, ils se rencontrent et l'on observe de plus en plus de combinaisons. Tout cela peut être lié au changement climatique, mais c'est difficile d'aboutir à une conclusion simple.
Les microplastiques sont des supports pour diverses molécules et organismes vivants. Cela peut entraîner des effets que l'on ne mesurait pas par le passé.

Je voulais vous interpeller sur la coresponsabilité de l'usage de l'eau, même si le sujet peut sembler très vague. Je parle du code et de l'usage de l'eau. Nous sommes tous alertés sur l'usage de l'eau, par exemple au sujet des productions bovines, qui sont décriées car très consommatrices en eau. Mais quelle est la quantité d'eau absorbée par l'humain au quotidien ? J'aimerais avoir votre avis sur cette coresponsabilité.
Pouvez-vous également me donner votre avis sur l'expérimentation menée dans certains secteurs, à travers le programme Ecod'o, qui concerne les entreprises industrielles ou agroalimentaires, au-delà de l'agriculture ?
Avec toutes les contaminations que vous évoquez, ainsi que les effets cocktails entre polluants, ne pourrait-on pas se retrouver de plus en plus avec des terres souillées, qui deviendraient inutilisables en agriculture ? Je mets entre parenthèses tous les aspects juridiques.
Peut-être, en effet, en raison de la rémanence des molécules dans le sol. Mais, à l'inverse, nous constatons, avec le changement climatique, des érosions beaucoup plus importantes. À l'avenir, il faudra éviter les sols nus, en mettant des couverts végétaux l'hiver. Mais il faut, pour cela, un minimum d'eau en fin d'été ou en début d'automne. En Haute-Garonne, nous n'arrivons pas à les faire pousser. Ce sont ces couverts qui nous permettent de préserver la qualité de la terre. Dans certains territoires, la productivité a baissé parce que les sols se sont appauvris en matières organiques.
Concernant l'élevage, sur le bassin d'Adour-Garonne, un tiers de la surface agricole utile est en prairie. Si on perd l'élevage, on perd ces prairies. Si on laisse en friche, au printemps, cette friche va pomper l'eau au lieu de la restituer. Sur notre bassin, les prairies naturelles stockent sept milliards de mètres cubes d'eau : c'est trois fois plus que l'ensemble des stockages des retenues collinaires du bassin d'Adour-Garonne. L'eau stockée dans ces prairies naturelles est ensuite restituée dans les rivières du bassin. Ce cycle est essentiel.
Je voulais dire un mot sur Ecod'o, un programme initié dans le Morbihan et qui s'est généralisé à l'ensemble de la Bretagne. On le voit aujourd'hui déployé en Pays de la Loire. C'est l'une des mesures que les chambres de commerce et d'industrie s'engagent à mettre en œuvre dans le cadre du plan Eau du Gouvernement, à travers leurs dispositifs d'accompagnement des industries. Il existe de nombreuses solutions techniques et les industriels s'engagent résolument dans ces démarches d'économie d'eau.

J'ai une question sur le phénomène des méthaniseurs et leurs dérives, qui génère des impacts sur les nitrates et la qualité de l'eau. Avez-vous déjà fait des corrélations entre ces dérives de la méthanisation et les pesticides ?
Si la méthanisation s'accompagne d'une céréalisation d'un territoire, oui, mais c'est en raison de la nature de ces cultures, qui remplissent les méthaniseurs.

C'est ce que je voulais vous faire dire ! Vous avez parlé de l'Ampa, le métabolite du glyphosate. En cas de ré-autorisation du glyphosate, j'imagine que vous allez alerter le gouvernement. Pensez-vous que l'Anses, qui a coproduit l'étude ayant permis à l'Efsa de prendre la position que vous connaissez, et à la Commission de faire cette proposition d'une ré-autorisation de dix ans au maximum, a suffisamment pris en compte la question des métabolites du glyphosate ?
Je n'ai pas lu d'avis sur les métabolites. On a vu des avis sur le glyphosate.
Nous accompagnons des études sur les métabolites du glyphosate au CNRS de Chizé. Je crois qu'ils travaillent sur des têtards. Effectivement, beaucoup de difformismes sont constatés sur ces animaux.

Nous aurons probablement encore des questions à vous poser, que nous vous transmettrons. Nous avons eu connaissance, dans le cadre d'un avant-projet de loi d'orientation de l'agriculture, de l'hypothèse que le stockage et le prélèvement de l'eau pour les bassines destinées à la production agricole soient réputées d'intérêt public majeur. Cela semble intellectuellement en contradiction avec la logique des PTGE, lesquels créent une démocratie, un état des lieux territorial, en vue de mettre en place des solutions partagées dans le temps. Qu'en pensez-vous ?
Nous ne pouvons pas échapper au dialogue territorial. C'est central. Si nous souhaitons que de tels projets soient acceptés dans un territoire, il faut accepter de participer, de construire un dialogue territorial, si nécessaire en se faisant accompagner par des experts des sciences sociales, parce que ce ne sont pas les techniciens qui peuvent véritablement répondre à toutes les questions que nos concitoyens se posent. On constate toutefois que les échelles successives de recours – tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État – avec des délais qui peuvent être parfois très longs, compliquent beaucoup la capacité des acteurs à se projeter dans une transition. Nous voyons dans nos bassins versants que tout est attaqué et qu'une fois qu'un tribunal administratif a pris position, la cour administrative d'appel intervient. Tout remonte ensuite au Conseil d'État, dix ans après. Dans ce contexte, comment les acteurs économiques peuvent-ils se positionner ? La longueur de ces procédures pose problème.
Faire le pari d'aller vite, c'est souvent faire le pari d'avoir des recours et, aujourd'hui, on les perd tous. Les volumes prélevables doivent être adaptés au changement climatique. Sinon, on aura du mal à maintenir des autorisations devant les tribunaux administratifs. Dans mon territoire, on a gagné un seul contentieux.
Il faut garder ce dialogue territorial. Sur notre bassin, 88 PTGE vont être mis en place d'ici la fin de l'année. Les deux tiers du territoire seront couverts par des projets de territoire basés sur les Sage. Tout fonctionne très bien. Le problème concerne plutôt les projets antérieurs, sources de conflits. Aujourd'hui, nous sommes capables de mettre en place ces projets en moins de deux ans ; il suffit d'être un peu patient.
La séance est levée à treize heures.
Membres présents ou excusés
Présents. – Mme Anne-Laure Babault, M. Grégoire de Fournas, M. Jean-Luc Fugit, Mme Nicole Le Peih, M. Dominique Potier, M. Loïc Prud'homme, M. Michel Sala, M. Nicolas Turquois
Excusé. - M. Frédéric Descrozaille